 WHAT AM I DOING HERE
WHAT AM I DOING HERE
ou
“ WHAT AM I WRITING HERE? ”
Publié dans Les Cahiers FORELL, Université de Poitiers, 1994
Se sachant condamné, Bruce Chatwin entreprit de réunir, peu de temps avant sa mort, sous le titre de What Am I Doing
Here, la quasi totalité des fragments, histoires, portraits et récits de voyage rédigés entre 1974 et 1988.
Le titre reprend, sans le point d’interrogation que l’on pouvait attendre, la première phrase du premier récit : “ Assunta
– A Story ”, deux pages comptant parmi les toute dernières écrites par Chatwin, et qui sont peut-être, contrairement à ce que suggère l’indication de “ story ”, les plus autobiographiques que
l’auteur ait jamais écrites. Comme, par ailleurs, Chatwin a eu la malice de nous avertir en introduction que chaque fois qu’un de ses textes était précédé de la mention “ story ”, « the
fictional process [had] been at work » (xi), laissant entendre (à tort, évidemment) que les autres textes n’étaient pas – au moins en partie – fictifs, le lecteur est immédiatement installé en
plein brouillage, à l’écoute d’un créateur qui dessine, avec humour et fermeté, la griffe de son pouvoir auctoriel et de sa liberté.
Chatwin fut superbement un homme libre, inscrivant son écriture dans l’immense espace de liberté de tous les écrivains qui
savent dire “ je ”. Sa quête fut, on l’a dit, celle du “ référent ” (Martin, 1989), dans une tension permanente vers la racine des choses, et même vers leur origine, origine que l’on sait
désormais “ en partage ” (Sibony) puisque – et il y a là une constante obsédante chez Chatwin – le singulier n’est personnel que parce qu’il est universel.
Écriture dans les deux acceptions principales du terme : art et manière. Écriture de liberté en ce qu’elle est le
cheminement d’une conscience au travers d’expériences voulues, assumées et, presque toujours acceptées. Écriture de liberté parce que résultat d’une démarche raisonnée, d’un passage de
l’ontologique à l’éthique par le biais de l’esthétique. Écriture dont l’esprit est proche de celle des dialogues platoniciens car elle postule un lecteur lui aussi libre, ouvert, non inféodé
aux préjugés. Écriture qui trans¬met un “ je ” polymorphe, polyphonique, mais assurément unique, un “ je ” d’autorité mais non autoritaire, un prisme filtrant et réverbérant une constellation
de référents inattendus mais vite familiers, un “ je ” foncièrement chaleureux, altruiste, vivant.
On ne saurait classer ces textes sous une seule rubrique, ne serait-ce que parce Chatwin les a confiés à des organes de
presse qui, dans une certaine mesure, ont déterminé leur nature. Mais tous ont en commun un classicisme, un dépouillement dans l’expression mis au service de thèmes parfois flamboyants et
toujours inopinés. C’est ce style, cette grande cuisine qui solidifie des pensées, des sentiments que des pulsions peut-être instinctives et désordonnées auraient condamnés au désaccord. Et
parce que la vie, selon Chatwin, est un glorieux faisceau de virtualités, tous ces textes s’achèvent sur des ouvertures, des points d’interrogation, des absences de solution posées humblement
comme solutions provisoires, mais qui valent comme solutions.
Comme tout bon rapporteur qui s’exprime à la première personne, Chatwin observe ses sujets selon plusieurs angles, mais
sans prétendre à la globalité. Comme tout producteur de diction préméditée, il use d’un style qui convient à sa démarche digres¬sive et forcément nomade, parfois interrogative ou faussement
innocente, souvent af¬firmative, où la description l’emporte sur l’analyse, où la suggestion prend le pas sur l’explication. La pensée n’est jamais brouillonne, la rigueur a généralement le
primat sur les effets de manche ou le brillant, l’honnêté renvoie dans les cordes la démagogie ou la fausse complicité. Les textes qui constituent ce recueil ne visent certes pas à prêter à
l’auteur des accents de prophète laïque, et ne lui confèrent point l’image d’une grande figure intellectuelle ou d’un guide, même si on ressort de leur lecture ébloui par tant de culture et
d’empire sur soi-même. Il n’y a pas chez Chatwin cette démarche commune à nombre d’essayistes qui consiste à peser le pour et le contre, à “ essayer ” (saggiatore). Il n’y a guère
d’incertitude ou d’errements dans le voyage physique et mental de cette plume vagabonde, point d’ornières non plus, même s’il a colligé ses textes sous ce titre étrange, qui interroge à la fois
sa personne, sa démarche et son écriture : “ What Am I Doing Here ”. Empruntée à Rimbaud en Éthiopie, ce titre n’est pas l’expression, comme chez le poète, d’une impasse : il signifie, par delà
l’acceptation du terme de la vie, un étonnement, une lassitude après tant de déplacements géographiques, le triomphe, quand tout a été dit, de la banalité (et “ Assunta. A Story ” est une
histoire prodigieusement triviale) sur l’existence dans toute sa richesse, une interrogation fondamentale de Chatwin sur son quant-à-soi et son rapport au monde.
What Am I Doing Here est traversé – pour reprendre l’expression de Lukacs – par une poétique du désir. Désir
d’établir une relation forte avec l’autre, désir non de trouver une vérité arc-boutée sur une conviction (même s’il ne se cache jamais derrière son doigt d’humaniste de gauche), mais désir de
ciseler dans et par l’écriture une forme unique, une pensée instantanée et inaltérable. Chatwin est un inlassable pourfendeur du principe de réalité. Il prévaut chez lui une recherche de ce qui
devrait être, après avoir testé ce qui peut ou pourrait être. En ce sens, il s’inscrit dans la tradition des grands essayistes britanniques, qui tentent le diable (ou Malraux ou Indira Gandhi),
qui ne font pas comme si, mais qui cherchent le pour quoi des êtres et des choses. S’il y a des lignes dans la pampa, si un Algérien immigré devient fou, si l’Inde est condamnée, pour longtemps
encore, au matriarcat ou à ses succédanés haïssables pour la conscience démocratique, la raison est prosaïquement dans l’homme, et il est du devoir de l’observateur exigeant de la
chercher.
En tant qu’essayiste, Chatwin est post-moderne au sens où il ne souhaite pas revenir sur ce que Lyotard (66) appelait une «
commémoration de l’impasse du lan¬gage ». On sent au contraire chez lui un désir de renaître par le langage, une confiance dans sa propre expression, le plaisir de se livrer à la satire d’une
herméneutique qui se prend au sérieux. En témoi gne par exemple cette appréciation tonique d’Ernst Jünger :
He writes a hard, lucid prose. Much of it leaves the reader with an impression of the author’s imperturbable
self-regard, of dandyism, of cold-bloodedness, and, finally, of banality. Yet, the least promising passages will suddenly light up with flashes of aphoristic brilliance, and the most harrowing
descriptions are alleviated by a yearning for human values in a dehumanised world. The diary is the perfect form for a man who combines such acute powers of observation with an anaesthetised
sensibility. (300)
Combiné à cette allégresse, il y a chez Chatwin – ce qu’on retrouve chez maints essayistes – un réel scepticisme qui se
démarque du relativisme de notre fin de siècle. Domine chez cet auteur, en particulier le redécouvreur de l’Australie, une volonté de rejoindre, même au niveau du mythe, la perfection des
origines. Par delà le Livre, Rousseau et une vision progressiste des relations humaines, Chatwin ne résiste pas à la mélancolie du désenchantement de l’Histoire. Il recherche l’origine d’un
Tout qui serait dépourvu de finalité, il chemine sur des routes qui semblent ne plus vouloir déboucher sur le moindre achèvement. Les récits mythologiques auxquels il fait appel ne semblent
pas, malgré leur beauté, leur sagesse, pallier l’encrassement des récits occidentaux. Chatwin s’avoue « mystifié » par les belles histoires qu’il nous raconte (345), il « résiste à la tentation
» d’appeler le passeur de l’île de Chiloé (351). Il y a chez cet auteur, un regret, et un refus devant la modernité de tous les systèmes devenant chaque jour plus performants et chaque jour
plus complexes. Son nomadisme est une réponse alternative, qu’il sait évidemment insuffisante, à l’absence de contestation globale, ou, plus simplement encore, au manque de réflexions radicales
de l’Occident sur lui-même. Alors, comme le mouvement a cessé d’exister, Chatwin bouge, sur ses pieds et dans sa tête parce qu’il n’est pas à l’aise dans le monde, parce qu’il sait les
consensus trompeurs, parce qu’il se méfie des faux débats, de la communication à sens unique. Tout comme un chef d’État qui ne lui ressemble en rien, il est fidèle à sa “ part d’ombre ”, en ce
sens qu’il obéit à l’obligation impérative d’une expérience personnelle où il se réserve le droit de dire étrangement l’étrange, de nommer le refoulé, de formuler l’im¬pensé, en un mot de
retrouver la création du Tout. S’il se demande, au seuil de la mort, ce qu’il peut bien faire ici, c’est qu’il laisse parler sa relation au néant. S’il pose cette question dans le cadre de son
échange manqué avec Assunta, l’aide-soignante immigrée, cet être décalé, déstructuré, hors la culture comme lui sera bientôt hors la vie, c’est justement parce qu’il veut affirmer que la
culture occidentale, en ce qu’elle a d’éclaté, de dissocié, de déraciné cache notre rapport au Tout, mais aussi au néant.
Il est clair que pour Chatwin l’expérience humaine est exotique, insoupçonnée, illimitée. Rapporter une expérience procède
d’une démarche quelque peu cornue puisqu’elle consiste à dire à un interlocuteur qu’on ne connaît pas, qui ne vous a rien demandé, qui, par définition, n’est pas à votre hauteur, ce qui vous
habite secrètement. Rapporter une expérience, c’est donc payer une dette que l’on croit avoir à un créditeur absent. Chatwin résout cette contradiction en s’adressant au lecteur comme s’il
n’existait pas, en proposant des évidences comme si elles étaient de toute éternité : «Howard Hodgkin is an English painter whose brilliantly coloured and basically autobiographical pictures
[…] fall into none of the accepted categories of modern art. » (70), « Madeleine Vionnet is an alert and mischievous old lady. » (86), « Maria Reiche is a tall, almost skeletal mathematician
and geographer. » (94), « The career of André Malraux has startled, entertained, and sometimes alarmed the French. » (114), « [Klaus Kinski] leaves a trail of smouldering resentment wherever he
goes. » (143), « George Costakis is the leading private art collector in the Soviet Union. » (153), « The Emperor Wu-ti was the most spectacular horse-rustler in history. » (195), « However
momentous the fall of the Roman Empire may seem in retrospect, it was merely an episode in a conflict between two incompatible, yet complementary, systems, nomadism and settled agriculture. »
(216), etc.
Par ailleurs, Chatwin n’oublie jamais – mais sans pour autant que le procédé de¬vienne pesant –, d’authentifier ses
fragments, même dans ceux qu’il qualifie de “ story ”. Ainsi, dans l’hôpital où il lutte contre la “ malaria ” (5), il prend bien soin d’historiciser son expérience (« I went to Ghana where a
film director was making a film based on one of my books. »), mais il répugne, préservant sa “ part d’ombre ”, à nommer sa maladie : « having recovered from a very rare Chinese fungus of the
bone-marrow ». Malgré une immense pudeur, Chatwin ne peut empêcher que la santé et la mort habitent les trois premiers textes de What Am I Doing Here. Le recueil a ceci de poignant que
des pages dont l’un des objectifs majeurs était d’exprimer la vie dans toute sa force et sa diversité furent rassemblées par un homme condamné à brève échéance, un grabataire que le mal avait à
ce point affaibli qu’il lui était quasiment impossible de tenir un stylo, un homme que son père avait voulu protéger du spectacle de la mort et dont la mère avait souffert de cécité pendant des
années (10), un homme dont le corps dépérissant trouva l’énergie ultime pour rassembler, pour constituer une œuvre avec des éléments disparates. Le paradoxe de cette ouvrage, mais ce qui en
fait sa vigueur, est que Chatwin, qui a toujours réussi à ce que chacun de ses livres soit différent des autres, a offert un assemblage constitué par un auteur ayant voulu, à la fin de sa vie,
donner un sens, une homogénéité à son travail journalistique, en colligeant des textes que seuls la mort pouvait rassembler sous cette forme. Mais il reste dans la construction du livre une
imperfection (voulue comme celle des facteurs de tapis orientaux pour qui dieu seul a le privilège de l’achèvement idéal) qui dit le combat de l’homme avec la mort. What A I Doing Here
semble ne jamais vouloir se terminer. Après les derniers récits de voyage (“ On Yeti Tracks ” et “ A Lament for Afghanistan ”), qui font suite à trois portraits rassemblés sous la rubrique “
PEOPLE ”, Chatwin nous redonne “ TWO MORE PEOPLE ”, et non des moindres (Jünger et Madame Gandhi), avant un “ CODA ” constitué de deux textes très poignants (“ The Albatross ” et “ Chiloe ”),
et une ultime rubrique, “ TALES OF THE ART WORLD ”, regroupant quatre textes, dont le dernier, “ My Modi ”, écrit en 1988, n’a que peu d’intérêt journalistique, mais où l’auteur réfléchit –
trop brièvement, mais il va bientôt mourir – à son art.
Le contrat de lecture et d’écriture de What Am I Doing Here est non seulement minimal, léonin, mais aussi
légèrement désinvolte. Après tout, les destinataires de ces pages auraient pu se passer des précisions selon lesquelles l’auteur a partout exposé ses « idées » (à l’exception du texte sur
Madame Gandhi – mais alors, que faire des idées exprimées dans les essais sur Malraux, Jünger ou le gourou Mel Lyman?), et qu’il a toiletté ses articles pour éviter les répétitions et les
passages faibles. Il nous semble plus intéressant d’évoquer l’engagement de Chatwin dans ses textes. Dans ce domaine, il apparaît pleinement comme un auteur de son temps. On sent un créateur
conscient des problèmes de sa propre langue, et désireux de les résoudre à partir de son idiosyncrasie. Parce qu’il a l’ambition, comme disait Robbe-Grillet (137) de « servir un jour peut-être
à quelque chose », Chatwin veut avant tout être artiste. Voyons par exemple comment dans “ A Coup. A Story ”, l’un de ses textes les plus ambigus, il joue du mythe des tropiques, et également
de l’écriture sur les tropiques pour les ridiculiser mais aussi, parce que ce mythe et cette écriture sont provisoirement nécessaires, pour les légitimer :
The coup began at seven on sunday morning. It was a grey and windless dawn, and the grey Atlantic rollers broke in long
even lines along the beach. The palms above the tidemark shivered in a current of cooler air that blew in off the breakers. (15)
Faudra-t-il s’étonner en constatant que la suite de cette “ story” est la relation nauséeuse mais terriblement crédible
(même si – nous y reviendrons – Chatwin a sûrement bien joué avec cette histoire) d’un coup de force sordide et ridicule ?
Dire ce que réclame le lecteur, c’est indéniablement l’obligation à laquelle Chatwin répond dans la plupart de ses
entreprises. Mais il sait aussi parler quand l’autre ne demande rien, comme, par exemple, dans “ The Very Sad Story of Salah Bougrine ” (241) où, non seulement il informe les consciences
néo-coloniales françaises des réalités des poubelles de leur Histoire, mais où il leur dit crûment pourquoi elles ne veulent pas voir les drames qui se vivent quotidiennement sous leur
nez.
« La logique du récit est analogue à celle du jeu », a dit Václav Havel (166). Au travers des récits de Chatwin, l’humanité
se révèle comme un agglomérat de différences de surface, imposées au lecteur par le hasard des rencontres et la nécessité des choix. Mais sous l’inconnu, l’incongru, l’imprévisible, une fois
que Chatwin a appelé un chat un chat, il y a la découverte empathique, quoique légèrement distanciée, de ce que nous aurions toujours dû connaître. Voyons, par exemple, comment s’annoncent les
préparatifs d’une expédition sur les traces du yéti :
A dashing young sherpa pressed forward and introduced himself as our sirdar. His name was Sangye Dorje – which means ‘
Thunder-Lion ’. He moved with a certain military precision; and in his peaked cap, his waisted green tunic, boots and breeches, he could have played the role of a Kalmuck lieutenant in a
pre-war Soviet movie. He was always cheerful, always resourceful, and had the habit of prefacing his statements with ‘ I have something to say ’, and of closing with ‘ That is all I have to say
’.
The cook was his old school friend Nima Tashi, who was a wizard at sticky cakes, and whose left cheek was scarred with
a yak-horn cornada. The Third Sherpa, Pansang Nuru, was forever whirling prayer-wheels. Lastly, the cooks’s boy, Tham, a Magar from Central Nepal, was a shy doe-eyed boy of infinite sweetness
and theatrical tempera¬ment, who wore a scruffy red knitted cap as if it were Pulcinello’s. (272)
Ce passage illustre la tension entre le familier et l’inconnu, le contingent et le requis; il exprime le choc imprévu mais
fatal de déterminismes ô combien distincts, de mondes qui se révèlent brutalement l’un à l’autre, avec toujours cet arrière-goût – la surabondance de détails circonstanciels aidant – d’un
ancrage référentiel décisif, certes, mais tellement accessoire. Que nous importe en effet le nom du troisième sherpa ou la couleur des yeux du serviteur du cuisinier si nous ne savons rien de
l’organisation sociale des Tibétains ou de leur sens du beau ? Mais, justement, cette inflation d’effets de réels, ces descriptions-entonnoirs où sont aspirés tant de sujets différents, ces
analogies forcées sont la preuve que le destin (dieu, les forces qui donnent à l’humanité un semblant de cohésion) mène ou, en tout cas, devrait toujours mener, le semblable vers le
semblable.
Comme chez tout essayiste qui se respecte, le je est constitué avant le texte. Il surgit d’une origine connue de lui seul,
dans un lieu ou dans une posture faussement décalée (« I am flat on my back in a NHS Hospital. », 3), en passage (« We were driving in a taxi when the coup began, on our way to another country.
», 15), juxtaposé au centre d’intérêt (« I have a friend called Jack. », 36), en expédition improbable (« The man I had arranged to meet was standing by one of the two bronze lions that snarl
in the forecourt of the new Hong Kong and Shangai Bank. », 49), en auto référentiel (« In the summer of 1986, I completed my book The Songlines under difficult conditions. I had in
fact picked up a very rare fungus of the bone-marrow in China. », 63). Dans la même optique, et toujours pour introduire de manière indirecte son je et l’objet principal de ses récits, Chatwin
use fréquemment d’un intercesseur : « My mother had come back from her cataract operation » (“ Your father’s eyes are blue again ”), « I have a friend called Jack » (“ The Lyman Family ”), «
There was another Englishman staying at the Hôtel Beauregard » (“ Until my blood is pure ”), « The man I had arranged to meet » (“ The Chinese geomancer ”), « Olivier, your father and I have
known each other since I was eighteen. » (“ George Ortiz. For Olivier on his twenty-first birthday ”), « Last Easter Saturday, Father Joseph de Souza put on a fresly-laundered soutane » (“
Shamdev : the Wolf-boy ”), « On 18 June 1940, Mr Churchill ended his speech to the Commons with the words ‘ This was their finest hour! ’ » (“ Ernest Jünger : an Aesthete at War ”). Il s’agit
pour Chatwin de se préserver, de cheminer plus lentement, de permettre au lecteur une approche réfractée du cœur des textes, de rappeler que tout centre d’intérêt suppose une périphérie.
L’intérêt principal de ce statut, de cette élaboration prétexte est qu’à chaque écrit correspond une nouvelle facette du
je, un regard parfaitement neuf, une re-connaissance, une conscience arasée, une tabula rasa qui donne l’impression de ne reposer sur rien. Ainsi, lorsque Chatwin commence “ Until My
Blood Is Pure. A Story ” (42) par la phrase « There was another Englishman at the Hôtel Beauregard. », il se définit comme anglais, alors que l’Angleterre est singulièrement absente de ce livre
(et des autres, d’ailleurs) . Ou encore, lorsqu’il introduit “ On Yeti Tracks ” (371) par « This April, having spent the hottest part of the year in the Central Australian desert, I felt the
urge to get out of that tired red country and clear my head among some mountains. », on peut légitimement se demander ce qu’il était allé faire en cette galère. L’inconvénient est que face à un
fort sujet d’études, le je est instable, fortement influencé ou manipulé, comme dans les rencontres avec Nadejda Mandelstam ou André Malraux. Chatwin accepte que l’auteur de L’Espoir
ait rencontré Orwell et qu’il ait vu en lui un garçon timide (132) alors qu’il n’y eut jamais le moindre contact entre les deux hommes, mais surtout il se laisse volontairement hypnotiser (et
Malraux est particulièrement brillant lorsqu’il est dans la position du serpent cracheur face au lapin) par des télescopages, des analogies, des images ébouriffantes ou farfelues : « Lawrence,
en grandiose, c’est mai ’68. » (123), « And Tibet, there is always Tibet… » (135), « And Gengis Khan, how would you have stopped him? » (120). Ce je découvreur, spontané et vierge peut être
facilement piégé par la doxa, comme dans “ A Coup. A Story ” où nous est offerte une image complètement européo-centrée de l’Afrique, continent entièrement contenu dans le regard de l’autre,
dans sa culture incomplète et fragmentée :
No. This was not my Africa. Not this rainy rotten-fruit Africa. Not this Africa of blood and slaughter. The Africa I
loved was the long undulating Savannah country to the north, the ‘ leopard-spotted land’, where flat-topped acacias stretched as far as the eye could see, and there were black and white
hornbills and tall red termitaries. For whenever I went back to that Africa, and saw a camel caravan, a view of white tents, or a single blue turban far off in the heat haze, I knew that, no
matter what the Persians said, Paradise never was a garden but a waste of white thorns. (25)
Cette vision africaine, fortement influencée par les voyages de Mungo Park ou de René Caillé, débouche sur des analyses de
surface brillantes, mais incomplètes, voire fausses, car elles ne tiennent pas compte du substrat culturel et historique. Comme par exemple, quand il explique – en suivant la démarche de son
ami le musicien Kevin Volans – que ce qui distingue la musique africaine de l’européenne (par parenthèse, existe-t-il une musique “ africaine ” et une musique “ européenne ”?), c’est que la
première n’est pas « délibérément asymétrique », qu’elle n’a pas de proportion précise, que souvent la répétition n’est pas perçue, et que la mélodie peut s’arrêter aussi brutalement qu’elle a
commencé, comme le chant d’un oiseau. Nous sommes alors en présence de généralisations quasiment malruciennes, avec l’idée sous-jacente que la musique “ africaine ” n’est pas construite, ce qui
est totalement absurde (67). Chatwin a été stoppé dans son élan au moment où il aurait peut-être progressivement effacé de ses textes son je comme instance médiatrice, au moment où il se serait
efforcé, comme il l’affirme dans “ Chiloe ”, des pages saturées de symboles et de “ littérature ”, de «résister aux tentations de lancer des appels » (351), et donc de respecter purement, de
manière ascétique, le monde. La seule médiation face à l’univers et aux hommes se limitant alors à l’acte de reconnaître.
Le fait est que grâce à l’autorité de l’instance énonciative, le jeu du texte qui se fait, celui de l’auteur qui construit
et déconstruit son texte à mesure qu’il l’écrit, est généralement convaincant. Dans les très belles pages que constitue “ Rock’s World ” (206), le narrateur est donné sans explication : « The
doctor had seated us, with his four brothers, at the table of honour beside the east window. » Du fait de cette position de supériorité, renforcée par le fait que Chatwin convie ici une culture
éblouissante, il peut très harmonieusement, dans un texte de voyages, insuffler de la poésie exotique, donner une âme à sa relation grâce à des vers d’Ezra Pound.
Cette autorité a permis à Chatwin, au fil des ans, de s’ouvrir chaque jour davantage, de devenir plus avenant, moins
donneur de leçons. Il a su user de cette force pour quêter chez l’étranger et l’étrange, l’humanité commune, comme en témoignent particulièrement ses récits de l’époque où il était directeur
chez Sotheby. En authentique humaniste il recherche ce qui devrait unir les hommes dans l’espace et dans le temps. La critique a évoqué avec raison sa chaleur, couplée, moins bizarrement qu’on
pourrait s’y attendre, à ce qu’il appelait son « bleak chiselled style » (366). On peut alors regretter – mais cela est dû à la brièveté du genre journalistique qui rend difficile le jeu sur le
tremblement barthésien – que Chatwin, contrairement à Flaubert qu’il admirait (78), s’intéresse presque exclusivement à ce qui est, à ce qu’il voit dans l’instant, et pas au passage entre deux
états.
Cela dit lorsque, comme il nous en a averti, le travail de fiction est à l’œuvre, Chatwin se retranche derrière le prestige
de la confession tout en réclamant l’immunité que confère la fiction. Il gagne sur les deux tableaux, comme dans “ The Coup ”, qui nous semble avant tout comme un coup monté. Cette “ story ” de
1984 raconte un putsch au Bénin en 1978. Elle débute par un morceau de bravoure “ tropical ”, à priori inutile dans l’économie d’un texte sur un coup d’état : « Out at sea, beyond the surf,
there were several black fishing canoes. Buzzards were circling above the market, swooping now and then to snatch up scraps of offal. » (15) Elle se poursuit par l’utilisation de la technique
bien connue, voltairienne, de l’observateur naïf, de passage et qui ne comprends pas vraiment ce qui se passe autour de lui, du narrateur immédiatement en action (ou en passion), plongé, à son
corps défendant, dans l’Histoire : « We were on our way to Togo, to watch a football game. » Au début de la “ story ”, le je s’informe progressivement, ne saurait jurer de rien (« What’s that?
»). Le protagoniste est submergé par l’action en cours : « And now, what? », « How long? I shall never know. ». Mais petit à petit, il comprend le sens de chaque incident : « Well, I thought at
the sight of so many naked bodies. There must be some safety in numbers. » C’est que Chatwin dissocie le je du narrateur de What Am I Doing Here du je du protagoniste : celui-ci n’a
pas un accès direct et immédiat au savoir de celui-là. Les deux je ne finissant par coïncider qu’au terme de la “ story ”, et encore de manière insatisfaisante, interrogative :
‘ Which [scenario] do you believe? ’
‘ Both ’, he said.
‘ That ’, I said, ‘ is a very sophisticated analysis. ’
‘ This ’, he said, ‘ is a very sophisticated country. ’
L’inconvénient de la pseudo-innocence est, une fois encore, une certaine complaisance, une certaine passivité par rapport
au discours dominant, aux clichés, aux phrases toute faites, même placées dans la bouche d’acteurs autres que le protagoniste : « The Dahomeans are a charming and intelligent people. Their only
weakness is a certain nostalgia for taking heads. » (24) Lorsque Chatwin observe que « the bartender screamed wildly in African. » (16), il reproduit le stéréotype du nègre sauvage qui crie
dans une langue qui, évidemment, n’existe pas, sauf pour l’oreille incompétente de l’étranger: l’africain. Lorsqu’il invente la situation si peu crédible suivante :
‘ No ’, I said, submissively. ‘ I’m a tourist. ’
‘ Mercenary! ’, he shrieked, and slapped my face – not hard, but hard enough to hurt. (17),
ses lecteurs ne sont pas spontanément enclins à accepter que lors de ce putsch les Blancs ne furent ni inquiétés, ni
torturés. Signalons enfin que Chatwin laisse entendre que le coup d’État fut peut-être fomenté par le président de la république en personne (Mathieu Kérékou) pour faire se découvrir ses
ennemis. En fait, il s’est bel et bien agi, non d’un scénario “ subtil ”, mais d’une action internationale concertée pour renverser ce leader “ marxiste ” à l’africaine, dans laquelle furent
impliqués le Maroc, le Gabon, l’Afrique du Sud et certaines officines néocolonialistes françaises.
L’écriture de Chatwin est toujours transitive et ne vise qu’à la transitivité (Martin, op. cit.), en particulier du fait
qu’elle n’attire pas l’attention sur elle-même. Son style ciselé, économique convient en particulier à des textes où l’auteur recherche le rapport (ou les oppositions) entre l’original,
l’inutile, l’utilitaire et l’esthétique. A cet égard, ses pages les plus fascinantes sont peut-être celles consacrées à la géographe allemande Maria Reiche : “ Maria Reiche : the Riddle of the
Pampa ”, où l’“ énigme ” ressortit à la fois à cette scientifique hors du commun, et à ces lignes qu’il y a deux mille ans les habitants originaires de la région de Lima ont, sur un plateau
sans eau, tracé dans et sur un sol meringué, laissant ainsi des traces pour l’éternité. Par sa sobriété, son remar¬quable à-propos, la description suivante rend parfaitement justice à l’esprit
de géométrie et de finesse des Amérindiens chers à Maria Reiche :
The surface of the desert is furrowed with a web of straight lines, linking huge geometric forms – triangles,
rectangles, spirals, meanders, whip-like zig-zags, and superimposed trapezes – that look like the work of a very sensitive and very expen¬sive abstract artist. (94)
Flamboyant et rigueur font que Chatwin est attiré par le détail, la fioriture baroque, mais surtout par l’art simple,
utilitaire, fonctionnel. La photo de couverture de What Am I Doing Here représente, tout bêtement, pourrait-on dire, une porte d’échoppe en tôle ondulée peinte, en Mauritanie. Il n’est
pas inintéressant de signaler que dans ses carnets de voyage (1993), Chatwin n’évoque pas l’orfèvrerie mauritanienne, un domaine où l’artisanat excelle.
Chatwin recherche l’authenticité. Mais celle-ci dénie la perte. Chez les Aborigènes d’Australie, il repère en priorité ce
qui a survécu de leur culture, mais le fait est qu’il s’intéresse peu à la déréliction d’une grande partie de cette population. Dans un tout autre registre, on observe que dans “ The Lyman
Family. A Story ” (36), le narrateur est décalé, incongru, jamais en phase :
A small boy, about four or five, rushed in from another room and hugged my knees.
‘ Daddy, ’ he shouted, ‘ Daddee…! ’
I unclapsed his arms and knelt down.
‘ I’m not Daddy, ’ I said. (37)
La réalité de ces gens, eux-mêmes irréels et désaxés, le fuit. Il ne cherche pas même à donner un sens à cette rencontre.
Et, à la fin de l’épisode, il marque sa volonté de renaître, d’échapper à la suffocation physique et mentale dans laquelle l’ont plongé ces gens étranges : ‘ Whew! ’ I inhaled the freezing air.
‘ Never again! ’
Assurément, pour Chatwin, le réel n’est pas toujours nommable, s’il est souvent innommable. Le voyageur est balloté entre
la contrainte du réel dont il essaie de se défaire, et l’effraction de l’imaginaire sur lequel il n’a pas toujours barre. Ainsi, dans “ Until My Blood Is Pure. A Story ” (42), un texte
dédramatisant bien qu’il contienne implicitement toute la misère du Tiers-Monde, l’horreur n’est jamais bien loin malgré la façade convenue d’une Afrique pour touristes en goguette :
Belgian art dealers were buying fetish figures, piled head first and feet first like the photos of bodies in Belsen
(47).
Ce texte traite des maladies vénériennes, cette plaie d’Égypte dont il est si difficile de se débarrasser dans ce
continent. Le personnage qui en souffre, un Chinois à l’attaché case noir, a beau voyager à travers la “ jungle ” infestée de lions et d’éléphants, la souillure reste. Ce thème du voyage qui ne
purifie pas nécessairement nous entraîne vers l’objet central de What Am I Doing Here : le nomadisme. Comme par un fait exprès, “ Chatwin ” signifie “ chemin tortueux ”. L’auteur était
peut-être prédestiné, comme les contemporains de la Lucie de la grande faille, à être conçu pour être nomade, avec pour vocation première et authentique, celle de marcher sur terre. Il se
dépeint, systématiquement, toujours sur le qui-vive, prêt à prendre le premier train ou avion. La fonction phatique du nomadisme – comme celle de l’écriture – ne fait aucun doute pour l’auteur
: dans “Kevin Volans ” (63), il raconte que les Homo Sapiens voyageaient pour établir des contacts amicaux avec leurs voisins, et qu’ils résolvaient le problème de la consanguinité par
la parole. De tout temps, les tribus nomades ont acheminé des chants et des musiques, de tout temps les musiques ont transporté, au propre comme au figuré, les hommes. Pendant des siècles, dit
Chatwin, les nomades sont allés où ils voulaient grâce au chant, pendant des siècles, des musiques, venant de nulle part, et donc de partout, ont rapproché des hommes libres. C’est pourquoi
Chatwin aime tant la musique de son ami Kevin Volans, parce qu’elle flotte librement. Mais le nomade, en sa liberté, doit parfois accepter des contraintes pour créer : « Freedom is the absence
of choice. »
Chatwin aime le côté laïque du nomadisme. Marcher est en soi un rite, une réponse sous forme de catharsis, révolutionnaire
au sens premier du terme, au mystère des origines (220). Le nomadisme est une purge qui débarrasse l’individu de l’inadaptation personnelle. C’est pourquoi certaines Églises ont inventé le
pèlerinage à pied pour évacuer la mélancolie homicide des sédentaires frustrés (222). Même les colons de l’Algérie Française, ces hommes de la frontière surnommés avec bonheur pieds noirs,
étaient, dans leur genre, des nomades.
Du nomade au collectionneur, il n’y a qu’un pas. C’est d’ailleurs sûrement en collectionnant pour Sotheby, en frayant avec
l’hétéroclite, que Chatwin est devenu homme en passage. Après tout, un voyageur collectionne des souvenirs, les sites qu’il a visités. What Am I Doing Here présente quelques fortes
personnalités de collectionneurs qui lui servent à se décrire lui-même : « Hodgkin is an English painter whose brilliantly coloured and basically autobiographical pictures, done both with
bravura and with anxiety, fall into none of the accepted categories of modern art. » (70) Le collectionneur que Chatwin affectionne est un passionné qui n’étiquette ni ne classe, qui voyage
dans la constellation d’objets qui se montrent eux-mêmes sans qu’on ait besoin de les mettre en évidence, qui aime le bric-à-brac de l’existence et du monde (157).
Jouissance du nomadisme, du “ collectionnisme ”, jouissance de l’acte d’écriture, dont on dit qu’il est l’acte sexuel par
excellence. Fernando Pessoa pensait qu’on écrit pour rendre la vie réelle. Avec Chatwin, nous sommes en présence d’un auteur dont la quête ne s’achève que quand le vécu est passé dans l’écrit.
Nous sommes condamnés à lui faire confiance, à admettre que ce qu’il a connu, c’est ce qu’il en a dit. Et rien d’autre. Cette convergence entre le voyageur et l’écrivain, ce perpétuel
va-et-vient entre lui et lui, sont remarquablement illustrés par un de ses derniers textes : “ The Albatross ” (343). Ces pages racontent l’histoire d’oiseaux réels, que l’auteur a peu de peine
à hisser au niveau du mythe, originaires de la Patagonie, et qui, après avoir perdu l’usage de leur mécanisme d’orientation, ont fini leur course dans les îles Féroé. Chatwin décide de se
rendre sur les lieux, et dans le train qui l’emmène à Aberdeen, il tombe sur un employé des wagons-lits, un vagabond du village planétaire comme lui-même n’aurait pas oser l’imaginer,
originaire de Punta Arenas, la ville la plus australe du monde, et, qui plus est, neveu d’une de ses vieilles connaissances amérindiennes. Ancien ravitailleur de bouées lumineuses à l’époque
d’Allende, ce petit employé au teint sombre a, quant à lui, achevé provisoirement sa course, à King’s Cross. Il est évidemment stupéfait quand Chatwin lui apprend qu’il se dirige vers l’extrême
nord des Îles Britanniques pour voir un oiseau qui vient de son pays. C’est évidemment parce que nous sommes dans ces pages en plein rêve, ou encore que le suspens d’incrédulité fonctionne à
merveille, que cette histoire ne peut pas ne pas être authentique.
Cet improbable employé compte parmi l’immense constellation des objets et êtres rares que Chatwin a voulu faire connaître à
ses lecteurs. Comme l’étonnant collectionneur George Ortiz qui ne vécut que pour porter des masques dans un théâtre d’ombres planétaire (59). Comme son ami Kevin Volans, élève de Stockhausen,
avec sa musique pour clavecin et viole, pleine des broussailles épineuses et des insectes d’Afrique (61). Le Yéti, dont la quête – nous le savons bien depuis Hergé – ne relève du miracle que si
on ne le trouve pas (271). L’albatros (343) qui permet à Chatwin de tailler quelques croupières à l’européocentrisme de Darwin. Chiloé, cette île d’ensorcellement qui rend muet (346). C’est que
le différent ramène toujours à soi. Le peintre anglais Howard Hodgkin, grand bourgeois protégé et culturellement privilégié, ne comprend réellement qui il est qu’à l’occasion d’une évacuation
aux États-Unis qui l’aide à se pénétrer du concept de la chute de l’Europe; puis quand, de retour sur le vieux continent, il saisit que le sens de la couleur chez les artistes indiens lui
offrira un moyen de se libérer de « l’impasse boueuse » où évoluent bien des artistes anglais. (73) Chatwin lui-même, qui ne parvient à une certaine profondeur qu’au cours d’une conversation
futile avec Nadejda Mandelstam (83) : elle lui explique comment – en citant l’exemple de Soljénitsyne – il faut passer par le mensonge pour atteindre la vérité en littérature. Chatwin, qui
admet auprès de la couturière Madeleine Vionnet que la simplicité dans la création est parfois le sujet de la plus extrême opulence (88). Chatwin, dont la culture est un mélange d’érudition et
de merveilleux, de nécessaire et de superflu, de contraint et de délire, une culture lui permettant de s’imprégner de l’autre sans effort apparent :
Every Nakhi woman carries the cosmos on her back : the upper part of the cape is a band of indigo representing the
night sky; the lower, a lobe of creamy silk or sheepskin. […] Girls come up from the kitchen with the sweet course. […] More girls then come with the ‘ Nine Dishes ’, the ‘ Nine Dragons ’.
(207)
Qu’importe alors si certains textes se terminent en impasse provisoire, l’important n’étant pas le résultat, mais le
cheminement, physique et mental, vers l’autre : « I came away convinced that Shamdev’s story was as convincing as any other. Someone should get to the bottom of it. » (240)
L’autre qui permet de lire l’un. C’est une approche fréquente chez les essayistes anglo-saxons, qui consiste à se réfléchir
dans l’autre, à réfléchir par rapport à l’autre en se faisant le reflet des pensées, de la démarche, de la personnalité d’un objet qui alimente les cogitations du sujet. Si la carrière d’André
Malraux a fasciné les Français, c’est pour les raisons que l’on connaît, mais aussi parce que la stature de l’écrivain découla moins de la force et de la beauté de ses entreprises que du
chef-d’œuvre que fut sa vie (118). Malraux, dont assurément Chatwin surévalue l’originalité d’une réflexion esthétique fortement influencée, entre autres, par celle d’Elie Faure, mais qui
envoûte notre auteur parce qu’il est une mémoire du monde ambulante, parce qu’il sait faire se télescoper les strates de nos souvenirs, et surtout parce que c’est un homme seul, sans épigone,
et un être qui, comme Chatwin, dialogue avec les mythes.
Mais le grand marcheur a aussi besoin de socles, de traces exemplaires où poser les pieds. Le nomade des années vingt et
trente Robert Byron, « gentleman, érudit et esthète », lui sert de modèle de voyageur et d’écrivain (288), tandis que le peintre Donald Evans, mort tragiquement dans l’incendie de sa maison
après avoir voulu « écrire » le monde par sa peinture lumineuse, lui fournit un idéal philosophique, une morale, une aspiration à unir le nomadisme et l’ordre :
I can’t think of another artist who expressed more succinctly and beautifully the best aspirations of those years : the
flight from war and the machine; the asceticism, the nomadic restlessness, the yearning for sensual cloud-cuckoo-land, the retreat from public into private obsessions, from the big and noisy to
the small and still. (268)
Se transporter des rêves à la réalité, comme le Jünger des Falaises de marbre (313) ; utiliser l’autre comme miroir
réfractant, tout en sachant que cet autre – c’est le cas de Maria Reiche, perçue par les Andins, comme une « folle », une « fanatique recluse » (99) – risque de vous renvoyer de vous-mêmes une
image aberrante; privilégier la perception ou la dialectique décalées, comme celles de Frantz Fanon comparant le colonialisme à une maladie mentale (251), ou celle de Chatwin lui-même usant de
la métaphore filée de la drogue pour dépeindre Marseille mafieuse (257). Épuiser le jeu des miroirs, utiliser tous les raccourcis possible pour rechercher ce qui unit dans l’espace et dans le
temps, afin, une fois les stéréotypes dépassés, de retrouver une vision de l’humanité commune. Tout cela pour faire partager son inclination à juxtaposer des cultures différentes, des œuvres et
des êtres similaires de cultures diverses et d’époques distinctes. L’avantage de cette préhension du monde étant de comprendre ce que l’autre comprend, de pouvoir s’installer dans le point de
vue de l’autre, qu’il s’agisse – dans un même texte – d’un raciste, d’un Arabe ou d’un pied-noir, de tirer le meilleur parti d’une extraordinaire réceptivité aux idées, aux concepts nouveaux,
de percevoir tous les niveaux de réalité, comme dans ce portrait d’un étonnant voleur de chevaux, accessoirement empereur de Chine :
He believed in his right to order the everyday existence of all of sixty million subjects, to tax the rich out of
existence and divert all money towards himself. Since, by the fact of his divinity, he controlled the seasons, his moods of love and hate merely reflected changes in the weather.
(195)
L’inconvénient étant de privilégier, certainement par passion, la surface des choses, au risque, même dans les
développements critiques, d’évacuer les causalités, les contradictions, les aboutissants :
The Nakhi are a passionate people and, even today, rather than submit to a hated marriage, young lovers may poison or
drown themselves, or jump to their deaths from the mountains. (213)
D’où, peut-être, des feux mal-éteints, des généralisations enfilées comme des perles, des erreurs, une vision trop souvent
folklorisée du monde.
NOTES
Chatwin est mort en janvier 1989, d’un “ champignon rare ” contracté en Chine, selon ses dires, du SIDA, selon d’autres
sources. En 1993, son épouse autorisa la publication par John Cape d’un magnifique ouvrage de “ Photographies et Carnets de Voyages ” (Grasset et Fasquelle pour l’édition française).
Une exception : un très court dialogue avec Diana Vreeland (p. 79.).
Edwy Plenel. La Part d’ombre. Paris : Stock, 1992. Dans cet essai, l’auteur explore les coulisses obscures du
mitterrandisme.
Le film en question était Cobra Verde de Werner Herzog, avec Klaus Kinski, tiré de son livre The Viceroy of
Ouidah.
On the Black Hills a pour cadre le Pays de Galles.
Chatwin a toujours dit n’avoir jamais recherché la beauté, s’être inspiré d’auteurs comme Hemingway ou D.H. Lawrence et
avoir constamment suivi le conseil de Noel Coward, de « ne laisser rien d’artistique se mettre en travers de son chemin. » (366).
« Flaubert’s description of Emma Bovary’s room in a hotel de passe in Rouen, before and after, but not during the sexual
act, is surely the most erotic passage in modern literature. » (78).
L’auteur de cette contribution, présent sur les lieux au moment du coup d’État, avance que dans ces lignes Chatwin est un
analyste et un observateur superficiels des réalités africaines.
Les Dahoméens (actuels Béninois) ne sont pas plus “ intelligents ” que les autres Africains. Disons que, pour des raisons
historiques et culturelles assez complexes, ils furent recrutés par les colons, de préférence à d’autres, pour accomplir des taches administratives et d’encadrement mineures. Ils furent ainsi,
davantage que les autres peuples de l’Afrique de l’Ouest, au contact de la civilisation du Nord. En outre, parler de “ Dahoméens ” est une généralisation au moins aussi abusive que d’évoquer
les “Anglais ” ou les “ Poitevins ”, sans même prendre en compte le fait que le Dahomey, en tant qu’entité géographique, est une projection de l’Européen. Cette projection n’a aucun sens en
termes de démographie, d’ethnologie, de culture africaines.
Pendant le coup d’État de 1978, il n’y a pas eu de témoignages d’Européens ainsi rossés. En tout état de cause, un soldat
africain voulant corriger un civil désarmé ne le frapperait pas à coups de poing mais à coups de matraque ou de chicote, ce célèbre fouet importé par les colons. C’est pourquoi il est difficile
de croire à la phrase suivante : « The subaltern had smashed his fist into the Belgian face. […] The subaltern kicked him when he was down. He lay on the dirt floor, whimpering. »(27) Et encore
moins à ce passage : « I stood like a school boy in the corner, until a female sergeant took me away for fingerprinting. […] When I tried to manoeuvre my little finger onto the inkpad, she bent
it back double. I yelled ‘ Ayee ’ and her boot slammed down on my sandal foot. » (28) On imagine mal une femme (même soldat et issue d’un peuple aussi “ intelligent ”) martyriser en l’humiliant
un Européen de cette manière.
« You hire a plane-load of mercenaries to shoot up the town. See who your friends are and who are your enemies. Shoot the
enemies, simple! » (21)
Pour les géographes conséquents, la jungle n’est pas africaine mais asiatique.
Julia Kristéva. Lire n° 213, p. 23.
Chatwin affectionne le paradoxe constructif : « My whole life has been a search for the miraculous – yet, at the first
faint flavour of the uncanny, I tend to turn rational and scientific. » (282)
Il y a chez Chatwin une volonté obstinée d’expliquer le monde dans sa totalité par une mythologie : «Aboriginals believe
that the totemic ancestor of each species creates himself from the mud of his primordial waterhole. He takes a step forward and sings his name, which is the opening line of a song. He takes a
second step which is a gloss on the first line and completes the linked couplet. […] I hoped to use this astonishing concept as a springboard from which to explore the innate restlessness of
man. » (63)
« The rich lived as the poor, drank the same fermented mare’s milk and ate the same lamb. » (198), «Our Shanghai friend,
Tsong-Zong, says we might well be guests at Brueghel’s The Peasant Wedding. » (207), « With her deep blue bonnet and smile of tender resignation she reminds us of Martha or Mary in a Florentine
altar piece. » (209).
Que de tensions, de haines, de frustrations, de répression dans cette rapide description de la Chine : «the world’s oldest,
subtlest, most intelligent civilisation » (214).
« Many Frenchmen were upset to be labelled ‘ racist ’. […] The French have a long-cherished belief that they are not, as a
people, racist; that racism is an Anglo-saxon malady they do not happen to share. They will admit to cultural chauvinism […] but the idea of a colour-bar is alien to them. » (246)
Elles ne manquent pas. Ainsi, dans le texte sur Georges Costakis, Lénine est le fils d’un directeur d’école, alors qu’il
est, dans “ The Volga ”, plus justement, fils d’un « school inspector ». Chatwin pense qu’avec Boumedienne l’Algérie est dans de bonnes mains (247). Il voit en Gaston Deferre un homme naïf
prisonnier des intrigues qu’il a lui-même ourdies (261). Sans parler de très nombreuses fautes de français (33, 43, 90, 118, 315, 358) ou d’ashanti (“ kenti ” au lieu de “ kinte ”,
144).
BIBLIOGRAPHIE
CHATWIN, Bruce. What Am I Doing Here. Londres : Jonathan Cape, 1989. Rep. Londres : Picador/Pan Books,
1990.
— Photographies et carnets de voyage. Paris : Grasset, 1993.
HAVEL, Václav. Essais politiques. Paris : Calmann-Lévy, 1989.
LYOTARD, Jean-François. Le Postmodernisme expliqué aux enfants. Paris : Galilée, 1988.
MARTIN, Jean-Paul. “ Bruce Chatwin : écriture contemporaine et « retour au référent » ”. TLE n° 7,
1989.
ROBBE-GRILLET, Alain. Pour un nouveau roman. Paris : Editions de Minuit, 1963.
SIBONY, Daniel. Entre-Deux. L’origine en partage. Paris : Le Seuil, 1991.
 Mieux qu'Édouard et sa Wallis : le roi du Siam Ananda Mahidol (de son vrai
nom Phrabat Somdej Phra Paramenthara Maha Ananda Mahidol Phra Athama
Ramathibodinthra).
Mieux qu'Édouard et sa Wallis : le roi du Siam Ananda Mahidol (de son vrai
nom Phrabat Somdej Phra Paramenthara Maha Ananda Mahidol Phra Athama
Ramathibodinthra).



 En 1945, de nombreux officiers nationalistes poussent le
ministre de la Guerre japonais Korechika Anami à organiser un suicide national : "cent millions d'hommes en poudre de diamant". Celui-ci refuse et accepte de débattre du destin de son pays à la
Conférence impériale du 14 août.
En 1945, de nombreux officiers nationalistes poussent le
ministre de la Guerre japonais Korechika Anami à organiser un suicide national : "cent millions d'hommes en poudre de diamant". Celui-ci refuse et accepte de débattre du destin de son pays à la
Conférence impériale du 14 août. Qu'est-ce qui est trois fois plus mortel que la guerre ?
Qu'est-ce qui est trois fois plus mortel que la guerre ?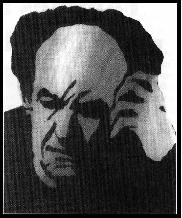 Mohamed Amzert, réalisateur algérien de 46 ans exilé en France, ne
Mohamed Amzert, réalisateur algérien de 46 ans exilé en France, ne  WHAT AM I DOING HERE
WHAT AM I DOING HERE Né en 1921, condisciple de Michel Jobert à l'ENA, Gérard Amanrich mena une brillante carrière de diplomate
jusqu'à sa nomination auprès du Saint-Siège.
Né en 1921, condisciple de Michel Jobert à l'ENA, Gérard Amanrich mena une brillante carrière de diplomate
jusqu'à sa nomination auprès du Saint-Siège. On connaît bien le destin héroïque et tragique de Salvador Allende, celui que
Pompidou nomma, après le coup d'État militaire, "le docteur Allende", comme si ce dernier n'avait pas été élu démocratiquement par le peuple chilien.
On connaît bien le destin héroïque et tragique de Salvador Allende, celui que
Pompidou nomma, après le coup d'État militaire, "le docteur Allende", comme si ce dernier n'avait pas été élu démocratiquement par le peuple chilien.

 Où
trouve-t-on le plus grand nombre de tigres au monde ?
Où
trouve-t-on le plus grand nombre de tigres au monde ? Neil Aggett, que les
racistes sud-africains appelaient "Kaffir Boetie", l'amoureux des nègres, milita inlassablement contre l'apartheid. Il est arrêté en novembre 1981 et mis au secret pour activités terroristes.
Torturé pendant deux mois, il se pend le 25 février 1982, à 28 ans. Le jour de ses obsèques, 100000 Africains observent un arrêt de travail d'une demi-heure. (Subtractio).
Neil Aggett, que les
racistes sud-africains appelaient "Kaffir Boetie", l'amoureux des nègres, milita inlassablement contre l'apartheid. Il est arrêté en novembre 1981 et mis au secret pour activités terroristes.
Torturé pendant deux mois, il se pend le 25 février 1982, à 28 ans. Le jour de ses obsèques, 100000 Africains observent un arrêt de travail d'une demi-heure. (Subtractio)./image%2F0549186%2F20210506%2Fob_74c4ce_capture-d-ecran-2021-05-06-a-07-56.png)