Á ce qu’on en sait, l’acte héroïque du colonel Beltrame n’est pas survenu par hasard. Officier de gendarmerie, Arnaud Beltrame intègre à l’âge de 30 ans l’Escadron de parachutistes d’intervention de la Gendarmerie nationale, une formation d’élite chapeautée par le Groupement de sécurité et d’intervention. Il y sert comme “ chuteur ”, parachutiste sautant de 8 à 10 000 mètres d’altitude, le plus souvent de nuit. En 2005, il assure – au péril de sa vie – l’exfiltration d’une ressortissante française en Irak, ce qui lui vaut la croix de la Valeur militaire.
Homme qui se veut complet, il est diplômé de l’École européenne d’intelligence économique. Chrétien, il est également franc-maçon, membre de la Grande Loge de France de rite écossais, que l’on peut qualifier de plutôt progressiste (cette obédience joua un rôle important dans l’acceptation de la contraception en France).
Une semaine avant sa mort tragique, le colonel Beltrame avait connu un drame personnel très éprouvant. Il avait enterré son père, âgé de 71 ans, mort d’une noyade en mer en août 2017. Son embarcation avait été récupérée un mois plus tard mais son corps n’avait été retrouvé qu’en février 2018 dans les filets d’un bateau de pêche.
Lorsqu’Arnaud Beltrame décide seul, de son plein gré, de risquer le tout pour le tout, y compris sa vie, pour sauver une employée du supermarché, il n’est pas mû par une impulsion soudaine de tête brûlée. Il se lance en connaissance de cause, avec une arme de poing – dont il ne pourra se servir – et un téléphone portable qu’il pourra laisser branché pendant tout le temps de la négociation. Sa tentative sera couronnée de succès, mais il y perdra la vie.
Lors d’un hommage national, le président de la République Emmanuel Macron a qualifié Arnaud Beltrame de « héros français ». Autant je crois savoir ce qu’est un héros, une personne de grand courage, auteur de hauts faits, autant j’ai du mal à concevoir ce qu’est un héros « français ». Tout comme j’éprouverais quelques difficultés à cerner ce qui distingue un héros belge d’un héros portugais. Sophie Scholl et Lucie Aubrac n’avaient pas la même nationalité mais elles menèrent, avec héroïsme, le même combat contre le nazisme. Se lever à mains nues contre la barbarie n’a pas fait de l’une une héroïne « allemande » et de l’autre une héroïne « française ».
Macron et les siens peuvent – sincèrement, j’imagine – admirer la geste du colonel Beltrame, tout dans leur parcours, dans leurs pratiques et dans leurs visées indiquent qu’ils sont aux antipodes du héros de Trèbes. Lorsque l’on casse ce qui appartient et sert à tous pour le seul profit d’une infime minorité, on est des destructeurs de civilisation, contrairement au colonel qui tenta, par des heures de discussion, de ramener un fanatique dans la sphère des humains. Lorsque l’on soumet La Poste aux exigences d’Amazon, lorsque France Télécom cesse d'œuvrer pour le bienfait des usagers et devient une pourvoyeuse d’objets au service de clients, lorsque l’on oblige la SNCF à entrer en compétition avec des sociétés privées qu’elle a dû elle-même créer et qu'on la fait fonctionner selon un logiciel mis au point par une entreprise privée étasunienne, on n’a plus que faire de l’intérêt général et de la République. On soumet le bien public à la convoitise du privé qui ne connaît que les égoïsmes et l’immédiat. Lorsque l’on fractionne le peuple des travailleurs (« Vous les anciens de la SNCF gardez votre statut, vous les nouveaux entrants, débrouillez-vous sans »), on tue la fraternité sans laquelle des héros comme Aubrac ou Beltrame n’auraient pu exister.
Je dirai que ce qui rassemble les héros, c’est qu’au nom d’idéaux, de grandes valeurs qui peuvent parfois les dépasser, ils agissent pour l’intérêt général contre les intérêts particuliers, le leur au premier chef.
La sécurité des citoyens n’est pas un service. C’est un droit. Comme l’éducation ou la santé. C’est en conformité à cette éthique qu’Arnaud Beltrame, pour l’employée du supermarché, mais aussi pour nous tous, est allé, en pleine conscience et en pleine lumière, à la rencontre de son destin tragique.
PS : je ne suis bien sûr pas le seul à connaître cette phrase de Brecht : « Malheureux les peuples qui ont besoin de héros », tirée de sa pièce La vie de Galilée, qui met en scène la lutte entre la science et la théocratie, entre la raison et l'obscurantisme.





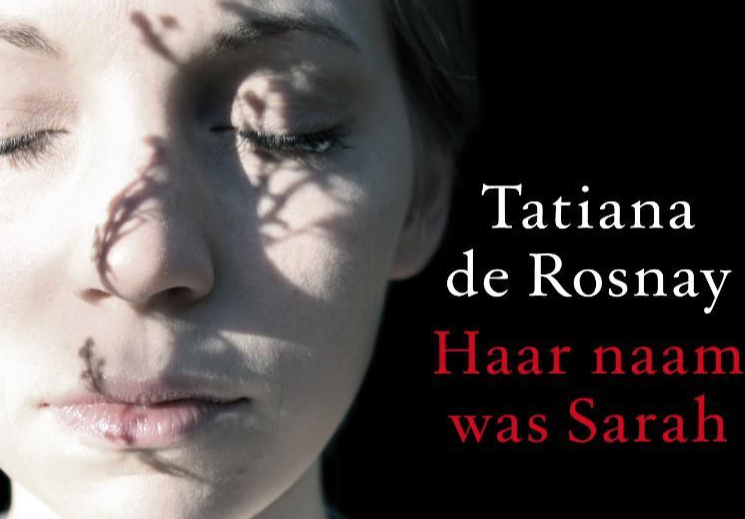




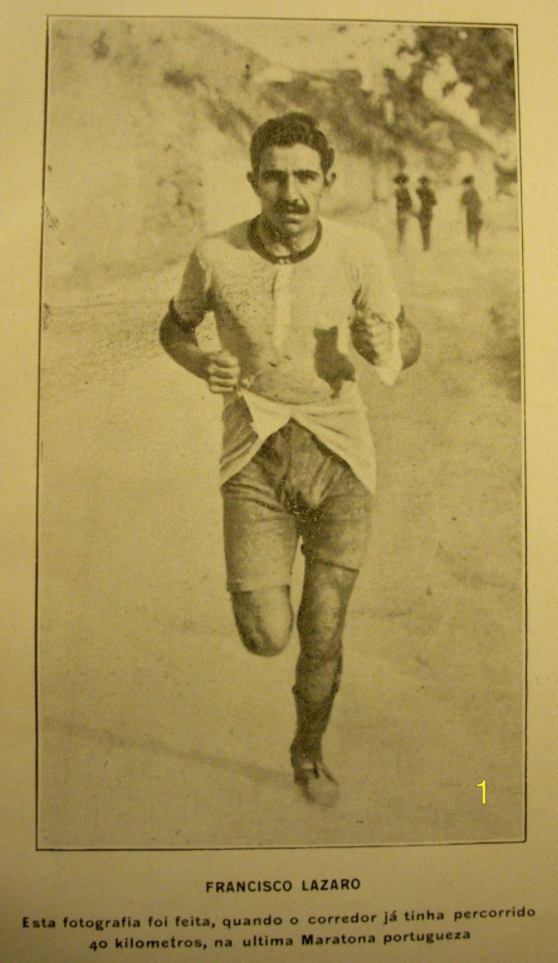


/image%2F0549186%2F20210506%2Fob_74c4ce_capture-d-ecran-2021-05-06-a-07-56.png)