J'ai été récemment censuré par nouvelobs.com où je tenais un blog depuis 2007. Je raconte à cette adresse : [http://blogbernardgensane.blogs.nouvelobs.com/] comment une jeune censeuse m’a puni, comme si j’étais un petit garçon. On peut lire, suite à mon article, des
commentaires de soutien, ainsi que l’inévitable intervention d’une blogueuse qui m’enfonce, proche de l’hystérie.
Je ne raconterai pas ici l’histoire de l’arroseur arrosé, mais celle de l’observateur arrosé. Il se trouve qu’il y a une dizaine d’années j’ai publié un livre sur
la censure au Royaume-Uni. À l’époque de la conception de cet ouvrage, je me suis informé sur la censure en France et aux États-Unis. Trente ans auparavant, j’avais pu avoir un aperçu substantiel
de la censure en RDA. Chaque pays a son histoire, chaque censure a sa forme. Mais le point commun que partagent toutes les censures, en pays démocratique comme en pays totalitaire, c’est la
bêtise et la mauvaise foi.
La censure sert toujours des intérêts politiques en se cachant souvent derrière une façade de moralité.
Je propose dans cette note un rappel de ce que fut la censure au XXe siècle dans le cinéma britannique.

Simone Signoret dans Room at the Top
Lorsqu’en 1912 se constitua au Royaume-Uni une instance de censure pour le cinéma, elle pensa tout de suite à interdire des scènes de crémation, de mise en terre, de meurtre, de suicide, de
désastre naturel, de baignade entre hommes et femmes, de combats de coqs et de chiens, des scènes bibliques, et aussi des plans où des portraits ou des photos d’officiels étaient ridiculisés.
Le Royaume Uni possède la censure filmique la plus sévère du monde occidental. Cette censure a évolué selon les circonstances politiques et les changements dans les
mentalités, mais elle a toujours répondu (quand elle ne les devançait pas) aux “ angoisses
respectables ”[i] de la majorité – silencieuse ou non – de la population.
La Loi sur le Cinématographe de 1909 (Cinematograph Act) visant, a priori, à
prévenir les risques liés aux conditions de sécurité, fut le premier texte réglementant les représentations filmiques.[ii] Cet loi donnait aux autorités locales le droit d’accorder, ou non, des d’exploitation. Elle leur
permettait en outre de réglementer les projections à leur guise, « dans les limites de la
raison ». À la surprise générale des premiers cinéastes, la jurisprudence autorisa les censeurs locaux
à porter un jugement sur le contenu des films. Des préoccupations purement techniques avaient donc débouché sur un examen et un jugement moral ou politique des premières œuvres
cinématographiques.
Dans le pays alors le plus urbanisé de la planète, les salles de cinéma s’implantèrent massivement dans les villes, donc dans des aires populaires et parfois
“ rouges ”. Les polices municipales, les classes possédantes, les juges, préoccupés par la montée du Parti Travailliste, par un taux de chômage assez important et par le climat de
délinquance qui pouvaient naître dans les lieux publics, en vinrent à réclamer des procédures de censure. On vit ainsi Le cuirassé Potemkine d’Eisenstein interdit de projection jusqu’en 1924 par crainte de propagation d’idées subversives.
. Le B.B.F.C.
Pour pallier le danger réel de censure totalement arbitraire et devancer le désir des autorités locales détenant
formellement le pouvoir d’interdire une projection, la profession proposa en 1913 de créer sa propre structure de réglementation : le British Board of
Film Censors ou B.B.F.C.(Office britannique des visas cinématographiques). Des membres de l’industrie
cinématographique s’instituèrent en censeurs de leurs propres activités pour délivrer eux-mêmes des certificats d’exploitation. Le changement en 1985 de “ Censors ” par
“ Classification ” ne devait pas altérer pas l’esprit correctif ou directif de cette institution officieuse.[iii] Le B.B.F.C. étant de toute façon un conseil consultatif, les autorités locales passèrent volontiers
outre aux recommandations d’une structure qui se targuait de son indépendance.
Depuis 1912, le B.B.F.C. est constitué de manière informelle, après accord entre les différentes branches de la profession, le ministère de l'Intérieur et les
représentants des autorités locales. Le ministre de l’époque, Reginald McKenna, accepta cette organisation sans pour autant consentir à ce que le ministère fût officiellement impliqué, donc
responsable devant le Parlement.
Le B.B.F.C. comprend un président (nommé par le ministère de l’Intérieur), un secrétaire (dont le rôle est prépondérant) et au moins quatre membres, nommés par le
gouvernement mais indépendants de lui et non révocables. Tirant ses ressources des droits qu'il perçoit pour visionner les films, il est financièrement autonome.[iv] Son pouvoir est censément celui d'un groupe de sages à qui il
revient d'attribuer un certificat à tous les films de fiction : “ U ” pour les films tous publics, “ A ” pour adultes (et enfants de douze à seize ans accompagnés de leurs parents), “ H ” pour les films d'horreur et “ X ” (sans rapport avec la
classification actuelle des films pornographiques) pour les films réservés aux plus de seize ans. Cette dernière catégorie, introduite en 1951 sur proposition du gouvernement travailliste de
Clement Attlee, provoqua des réactions ambiguës dans la profession. D'aucuns redoutèrent des pertes de recettes quand d'autres virent tout le profit publicitaire qu'ils pourraient tirer de cet
étiquetage.
A l’inverse du Code Hays (du nom du Président des Producteurs et Distributeurs de Films aux États-Unis de 1922 à 1945), le B.B.F.C. ne dispose pas d’un corps de
règlements statutaires. Cette absence n’a pas empêché, bien au contraire, des règles implicites et ponctuelles de s’ajouter les unes aux autres. Dès sa première année de fonctionnement, le
B.B.F.C. censura cent soixante-six films, en interdisant totalement vingt-deux d’entre eux. Les images punies allaient de la représentation du Christ à des scènes de danses indigènes susceptibles
de “ faire horreur ” à la sensibilité des Britanniques.
Le premier film censuré fut tourné sans comédiens et il avait pour vedette principale une tranche de Stilton. Le coloriste Charles Urban avait filmé au microscope les
veines bleues du célèbre fromage. Par crainte des réactions d’un public tourneboulé par la vision de bactéries, les industriels demandèrent que soient censurées les quatre-vingt-dix secondes de
ce documentaire. Cela n’empêcha pas, dès le début du XXème, la projection de films que l’on qualifierait aujourd’hui de gore : exécutions capitales,
décapitations de bandits chinois, pendaisons de Noirs aux États-Unis.[v]
En 1916, l’industrie cinématographique et les autorités locales accueillirent avec joie la nomination de Herbert Samuel[vi] comme nouveau ministre de l’Intérieur. Samuel proposa la création d’un
nouveau Conseil de censeurs placé directement sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, prévoyant qu’une censure d’État serait opérationnelle à partir de janvier 1917.
Les pères étant au front, les autorités considérèrent le cinéma comme le meilleur moyen d’éviter aux enfants l’oisiveté et la délinquance. Bien que plusieurs
organisations à but moral tel que le National Council of Public Morals(Conseil National de la Moralité Publique) eussent recommandé un durcissement de
la censure, la classe dirigeante britannique estima que le B.B.F.C. faisait parfaitement son travail et qu’une censure paralégale était, à tout prendre, un bien meilleur système qu’une
bureaucratie officielle. Pour être pleinement reconnu, le B.B.F.C. fit preuve d’une intransigeance toujours plus grande. Durant deux ans, il refusa la projection d’images de la guerre en cours.
En outre, suite aux grèves victorieuses des mineurs gallois en 1915, et un an avant le célèbre film de D. W. Griffith Intolerance, le B.B.F.C. interdit
toute référence aux “ relations entre le capital et le travail ”.
. La réaction des créateurs
Les créateurs ne restèrent pas longtemps les bras croisés devant la censure. En 1925, un noble de sensibilité communiste, Ivor Montagu, créa la Film
Society afin de pouvoir visionner des films importés selon des canaux privés. La crème intellectuelle de l’époque le rejoignit : Bertrand Russel, Aldous
Huxley, John Maynard Keynes, George Bernard Shaw, Roger Fry. Le B.B.F.C. ne pouvait s’opposer
légalement à la projection de films auxquels il n’avait pas accordé de certificat d’exploitation. Cependant, dès que ces films étaient vus par un nombre conséquent de spectateurs, il intervenait.
C’est ainsi que Metropolis de Fritz Lang (1926) fut largement amputé, que Le Cabinet du Dr Cagliari de
Robert Wiene (dans lequel un charlatan commet une série de meurtres atroces) fut retenu un bon moment au motif que, selon les censeurs, les scènes d’asile perturberaient les spectateurs ayant des
parents en hôpital psychiatrique. En 1931, M (M le maudit) de Fritz Lang fut censuré au point d’en devenir
quasiment incompréhensible.
. L’entre-deux-guerres
Entre les deux guerres, le B.B.F.C. fut placé sous l’autorité de personnalités caricaturales. Le principal examinateur, J. C. Hanna, était un ancien colonel de l’armée
des Indes, titulaire de la Croix de Guerre française et ancien combattant des troupes britanniques en Irlande. Il avait pour principale collaboratrice Miss N. Shortt, fille de Sir Edward Shortt,
président du B.B.F.C. depuis 1929. Ces deux censeurs ne firent jamais taire leur subjectivité, ce qui ne les empêcha pas de laisser passer des films d’outre-Atlantique avec des scènes très osées
car ils savaient que l’industrie cinématographique britannique était largement dépendante de Hollywood.[vii] Ils interdirent la projection de la version française de l’Opéra de quat’ sous
parce qu’il montrait des mendiants interrompant le couronnement d’une reine anglaise. Ils censurèrent en 1927 La Coquille et le clergyman de Germaine Dulac (sur un scénario d’Antonin Artaud) pour la raison que, de leur propre aveu, ils ne comprenaient strictement rien à cette présentation psychanalytique des
frustrations sexuelles. Ils s’avérèrent d’ardents défenseurs de l’honneur de l’Empire Britannique. En 1932, The Bitter Tea of General Yen de Frank
Capra, mettant en scène les amours d’une missionnaire blanche et d’un général chinois, fut projeté en Grande-Bretagne mais interdit dans l’Empire. G. B. Shaw fut le seul à leur tenir tête. En
1938, il réusit à les faire plier (fort symboliquement) en refusant que soit coupée la célèbre expression d’Eliza dans son scénario tiré de Pygmalion : « Not bloody likely » (vachement pas probable).
Jusqu’en 1940, face à la menace nazie, le B.B.F.C. éprouva quelques difficultés à reconnaître dans le Reich un ennemi réel et à envisager qu’une guerre sans précédant
se préparait. Après l’accession au pouvoir de Hitler, le B.B.F.C. refusa de certifier des films pouvant déplaire à Berlin ou au peuple allemand. En 1928, alors que le sentiment anti-allemand
était très fort dans la population anglaise, le B.B.F.C. censura, à la demande de Berlin, Dawn, un film racontant l’exécution par les Allemands d’une
infirmière anglaise accusée d’espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Le B.B.F.C. visionna les films britanniques anti-allemands tournés après 1933 dans l’optique de la politique
d’apaisement des Conservateurs. Il censura A German Tragedy et City without Jews, deux œuvres abordant le
sort dramatique réservé aux Juifs en Allemagne. C’est probablement parce que l’Allemagne n’est jamais nommée dans Les trente-neuf marches ou Une
femme disparaît que le Colonel Hanna et Miss Shortt ne censurèrent pas Alfred Hitchcock. En juillet 1939, Pastor Hall, qui raconte l’histoire vraie d’un pasteur torturé à Dachau pour son opposition politique, n’obtint pas le certificat d’agrément.
. La censure en temps de guerre
Avec le déclenchement des hostilités, la censure passa sous l’autorité du ministère de l’Information (Ministry
of Informationou MOI) nouvellement créé. Le MOI donna
systématiquement raison au B.B.F.C. contre les autorités locales lorsque ces dernières se montraient plus libérale que le Board. Les choix de la
censure reflétèrent le “ fighting spirit ” du gouvernement d’Union Nationale dirigé par Winston Churchill. Les autorités encouragèrent la distribution de
Pastor Hall. Love on the Dole, d’après le célèbre roman de Walter Greenwood sur les ravages de la crise
économique dans les milieux populaires, reçut son certificat d’exploitation, après avoir été censuré avant-guerre. Or il offrait deux scènes très dérangeantes pour l’époque : une action violente
d’ouvriers contre des policiers à la matraque légère et une jeune femme quittant sa famille totalement démunie pour se mettre au service d’un proxénète.
. Un après-guerre frileux
Après guerre, le B.B.F.C. et les autorités locales reprirent le contrôle de la censure, de par la Loi sur le Cinéma de 1952 (Cinematograph
Act). Le Président de l’organisme, Lord Tyrell, avait plus de quatre-vingts ans, l’examinateur en chef, le colonel Hanna était son cadet d’un an ou deux,
et le secrétaire du Board allait abandonner ses fonctions en 1948 après trente-six ans d’exercice. Hannah perdit la vue dix ans avant la fin de son mandat ![viii] L’accès au pouvoir, pour la première fois dans l’histoire de la Grande-Bretagne, d’un gouvernement travailliste majoritaire dont l’un
des mots d’ordre était “ Plus Jamais Ça ” incita le B.B.F.C. à prendre en compte l’engagement sociopolitique de nombreux cinéastes. Avec l’avènement en 1951
d’une majorité conservatrice non réactionnaire dans la mesure où elle ne remettait pas en cause les acquis principaux de ses prédécesseurs, le consensus domina et, à une ou deux exceptions près,
le B.B.F.C. ne censura plus de films sur des bases uniquement politiques. Cela dit, de 1948 à 1957, le Conseil rejeta cinquante films, soit six par an en moyenne.[ix] Durant cette période de redressement national et de
mieux-être économique, des expressions radicalement contestataires allaient surgir dans le théâtre, le roman et le cinéma.[x] Le B.B.F.C. réagit frileusement à ce bouillonnement en montrant une très grande
vigilance face au cinéma à vocation sociale. Le cuirassé Potemkine demeura interdit tandis que le Board mutilait sévèrement quelques films désormais classiques : Le diable au corps de Claude Autant-Lara en 1946, Brighton
Rock de John Boulting en 1947 (d’après Graham Greene), Riz amerde Giuseppe De Santis en 1948, Los
Olvivados de Luis Buñuel en 1950, Le Salaire de la peurd’Henri-Georges Clouzot en 1953, Sensode Lucchino Visconti en 1954 (rebaptisé par les censeurs The Wanton
Duchess, la duchesse impudique), The Wild One de László Benedek en 1954
(L’équipée sauvage, avec Marlon Brando). En 1955, de longs passages de Rebel without a Causede Nicholas Ray
avaient été censurés, en particulier ceux qui mettaient en cause l’autorité parentale.
. L’ère Trevelyan
De 1958 à 1971, le B.B.F.C. fut dominé par la personnalité de John Trevelyan. Guère plus libéral que ses prédécesseurs (il refusa une moyenne de douze films par an),
il élabora cependant une politique cohérente de censure cinématographique. Il se fit de la sorte respecter de la profession en la respectant, et sans renier ses principes et ses goûts
personnels.[xi] Il défendit
vigoureusement des films anglais posant des problèmes brûlants (comme The Young and the Guilty en 1958, tableau des frustrations sexuelles des jeunes),
mais il élagua énergiquement la même année Les amantsde Louis Malle. Sur des bases étroitement politiques, il interdit deux documentaires est-allemands
prouvant que d’anciens criminels de guerre nazis occupaient de hautes fonctions dans l’appareil d’État ouest-allemand.
Dans quel climat social, politique et culturel évolua alors le B.B.F.C. ?
Il est indéniable que ce que l’on appellera par la suite les Swinging Sixties marqua une avancée considérable en matière de libéralisation des mœurs.
Le retour au pouvoir des Travaillistes aidant, plusieurs lois firent de la Grande-Bretagne l'un des pays du continent européen les moins contraignants pour l'individu. Furent alors libéralisées
les lois sur l'avortement, le divorce, la contraception, l'homosexualité, tandis que la peine de mort était abolie. Fait remarquable, la plupart de ces lois furent discutées à l'initiative des
parlementaires (qui, dans plusieurs domaines, étaient en avance sur le pays réel) et non du gouvernement.[xii] Le cinéma avait précédemment joué son rôle d'éveil des consciences, en particulier par le biais de
l’ouverture de nombreux ciné-clubs permettant la projection de films non certifiés par le B.B.F.C.. Ainsi en 1956, Yield to the Night, avec Diana Dors,
avait mis en scène l'histoire vraie de la condamnation à mort d'une femme d'origine populaire ayant tué son amant d'origine bourgeoise. En 1961, Dirk Bogarde avait incarné un personnage
homosexuel dans Victim. L'année précédente, deux films avaient narré la vie d'Oscar Wilde (Oscar Wilde et
The Trials of Oscar Wilde). Rappelons qu'il avait fallu attendre 1958 pour qu'il ne soit plus illégal d'aborder le sujet de l'homosexualité au théâtre,
à condition que les personnages jouent un rôle réel dans l'intrigue et qu'ils ne s'embrassent ni ne s'étreignent sur scène. En 1969, Ken Russell pourrait filmer deux hommes luttant nus dans son
adaptation du roman de D.H. Lawrence Women in Love. En 1966, le problème de l'avortement était clairement posé dans Alfie (“ Alfie le dragueur ”, le premier grand rôle de Michael Caine), mettant en scène un prolétaire coureur de jupons, alors qu'auparavant le
simple mot “ avortement ” était interdit au cinéma et dans les œuvres de fiction télévisuelles. En 1967, le B.B.F.C. accepta le mot “ bugger ” (bougre, pédé)
dans les films (l'année précédente, le fameux critique de théâtre Kenneth Tynan avait utilisé le mot “ fuck ” dans un débat télévisé en direct[xiii]), et en 1968, on voyait pour la première fois une jeune femme
nue de face dans le film If de Lindsay Anderson. On peut par ailleurs constater qu'en ces années les pouvoirs publics (magistrats, conseils municipaux,
police), mais aussi les groupes de pression, les Églises se mobilisèrent beaucoup moins contre les bandes dessinées pornographiques, les clubs de strip-tease ou les sex
shops. De fortes réactions à la libéralisation purent néanmoins se développer. Ainsi en 1964 des militants lancèrent une “ Campagne pour une Télé Propre ” en créant une Association Nationale de Téléspectateurs. La B.B.C., qui avait été tant critiquée comme pilier de l'Establishment se
voyait traitée de pourvoyeuse d'obscénités.[xiv] Et on n'oubliera pas que l'Affaire Profumo date de 1963, avec, à la clé, le suicide, pendant son procès, du Docteur Stephen Ward, un
riche praticien homosexuel londonien, accusé – à juste titre – d'avoir présenté Christine Keeler, call girl de haut vol et maîtresse
d'un diplomate soviétique, au ministre de la Guerre conservateur John Profumo.[xv]
Lorsque John Trevelyan rédigea ses mémoires de censeur en 1973, il choisit pour épigramme cette phrase défensive et réaliste : « Les temps changent et il faut changer avec eux. »[xvi] Grâce à cette analyse il se dédouanait, peut-être à bon compte, d'une gestion ouverte mais ferme de la censure officieuse dont il avait
la charge. La liberté de création allait néanmoins connaître bien des embûches.
En mars 1954, un ancien cadreur de David Lean, Ronald Neame, lut le livre à succès de Michael Croft Spare the Rod.[xvii] Dans ce roman, Croft s'appuyait
sur son expérience d'enseignant pour raconter l'histoire d’un jeune professeur idéaliste nommé dans un collège difficile qui refuse d'employer des méthodes répressives à l'encontre d’adolescents
défavorisés très turbulents. Le B.B.F.C. envisagea un certificat “ A ” après quelques coupures. Le Président de la Rank, alors la compagnie de cinéma la plus importante outre-Manche, trouva
le scénario “ monstrueux ”, ne soutint pas ses créateurs et proposa des modifications qui dénaturaient le film. Le projet tomba à l'eau. Un projet remanié échoua en 1956. Une troisième mouture fut soumise
au B.B.F.C. en 1960. Audrey Field, la principale examinatrice du B.B.F.C., observa alors que le hooliganisme offrait un visage moins « méchant et plus enfantin ». Et, de manière très significative, elle fit une lecture purement réaliste du film, mélangeant faits et fiction, un peu comme si le
cinéma ne pouvait avoir de portée que cognitive : « Plusieurs des filles de
la classe de Sanders sont devenues de vilaines petites créatures. Notre pays est sur une mauvaise pente, et ce scénario est indéniablement une peinture réaliste de la
situation. »[xviii]
Un deuxième exemple, plus édifiant encore, serait celui de Room at the Top. Ce film, annonciateur du Free
Cinema[xix], était l'adaptation fidèle du roman éponyme de John Braine, publié en 1957, l'un des plus gros succès
de l'époque. L'histoire raconte la démarche totalement cynique de Joe Lampton, jeune homme ambitieux à qui son passé de prolétaire fait horreur. Pour se faire une place au soleil, il décide de
commettre quelques actions assez douteuses – comme épouser la fille du patron tenant la ville
sous sa coupe, après avoir fait une croix sur une passion torride qu'il venait de vivre avec une femme plus âgée que lui, Alice Aisgill[xx]. Room at the Top était une œuvre à
prétention sociale, mettant clairement en scène la lutte des classes. Les producteurs du film, John et James Woolf, choisirent de ne présenter leur œuvre au B.B.F.C. qu'une fois le film tourné.
Les censeurs émirent alors de très sérieuses réserves. Ils exigèrent ainsi que le mot “ lust ” (désir charnel) soit remplacé par “ time ” dans la phrase
“ Don't waste your lust ” – ce qui, vu le contexte, ne voulait plus dire grand chose – et que le mot “ bitch ” (chienne, salope) soit remplacé par “ witch ” (sorcière). Par
ailleurs, Alice Aisgill mourant à la fin du film dans un accident de voiture – épisode raconté et
non montré –, les censeurs ne purent tolérer qu'on dise de la femme qu'elle avait été
« scalpée ». L'équipe du film accepta ces injonctions, regrettant que le B.B.F.C. n'ait pas rétribué ses louables efforts, comme en témoigne une lettre de John Woolf à John
Trevelyan :
J'aimerais que l'épisode de la mort d'Alice ne fût pas trop édulcoré. Dramatiquement parlant, cet épisode est terriblement important et je pensais que le fait qu'Alice
périsse violemment serait perçu par les censeurs comme une fin morale. Comme je vous l'ai déjà dit, nous avions dans un premier temps imaginé filmer la scène, puis nous avons changé d'avis,
estimant alors que de faire raconter l'épisode par d'autres personnages ne poserait aucun problème de censure.[xxi]
Moralement parlant, la scène qui posa le plus sérieux problème fut celle où le héros Joe Lampton, et Mavis, une de ses conquêtes, viennent de faire l'amour. Ce moment
post-coïtal était parfaitement intolérable pour la censure.[xxii] La scène dut être rejouée afin d'édulcorer la forte connotation sexuelle. Le film fut programmé avec un certificat “ X ”, ce que la production
utilisa dans sa campagne promotionnelle : “ Une histoire sauvage de
désir et d'ambition ”.
La pièce de John Osborne Look Back in Anger (1956), œuvre phare des années cinquante, connut un très grand succès en
Grande-Bretagne et aux États-Unis. La compagnie Warner prépara une version cinématographique avec Richard Burton – déjà vedette de premier plan outre-Manche. Le scénario fut soumis au B.B.F.C. qui estima que le projet méritait un “ A ” pour l'histoire et un
“ X ”
pour la grossièreté du langage.[xxiii] Audrey Field s'offusqua des allusions à l'avortement de l'héroïne et, comme cela avait été le cas pour Room at the
Top, elle n'apprécia pas que Jimmy pût éprouver du plaisir à la simple évocation de ses relations sexuelles. Elle critiqua par ailleurs le discours sadique
de Jimmy souhaitant voir sa femme ramper par terre, la figure dans la boue. Un autre membre du Conseil analysa, quant à lui, le scénario d'un point de vue strictement réaliste en se demandant
comment une jeune fille éduquée et raisonnable avait pu tomber amoureuse d'un type aussi « minable ».[xxiv] Le B.B.F.C. demanda expressément aux scénaristes de supprimer le juron
“ Christ ” (à l'époque réellement plus blasphématoire qu'aujourd'hui) et de chercher des synonymes pour les mots “ salope ”,
“ vierge ” et “ bâtard ”. Il demande enfin que les allusions à l'avortement ne puissent pas être comprises par les enfants.
Le film de Karel Reisz Saturday Night and Sunday Morning (sorti en octobre 1960) était adapté du roman éponyme d'Alan
Sillitoe, publié en 1958, à l'époque, la troisième vente du siècle après L'amant de Lady Chatterley et Peyton Place. Il présentait la société anglaise comme coupée en deux, sans fraternisation possible entre les patrons et les ouvriers. Une nouvelle fois, le B.B.F.C. se montra sourcilleux face
à un essai d'avortement par un bain bouillant et une bonne rasade de gin. Un épisode cocasse opposa les censeurs aux créateurs à propos du mot “ bugger ”. Sillitoe
souhaitait que l'acteur prononçât le mot “ bogger ” comme on l'entend à Nottingham, mais le B.B.F.C. exigea qu'on entende “ beggar ” (mendiant), malgré
l'incohérence de la suggestion.
A Taste of Honey, film lui aussi adapté d'une pièce célèbre, posa des problèmes non négligeables aux censeurs. Tony
Richardson s'attaquait en 1962 à l'adaptation de la pièce de Shelagh Delaney, dramaturge de dix-huit ans. La pièce et le film s'en prenaient à un nombre impressionnant de tabous. L'héroïne est la
fille d'une prostituée “ indépendante ”, enceinte des œuvres d’un Antillais[xxv] dont elle s’est amourachée et qui l’a abandonnée une fois ses désirs assouvis. Elle se met alors en ménage avec un Anglais de souche,
dont on s'aperçoit rapidement qu'il est homosexuel. Le film fut classé “ X ” après suppression des “ Christ ” et de quelques expressions du style “ avoir un Polichinelle dans le tiroir” ou “ avoir le ballon ”. Pour décapante qu'elle ait pu être, cette histoire était tout à
fait en prise avec le réel quand on se souvient qu'à la fin des années cinquante, une enquête menée par la British Medical Associationavait, par
exemple, révélé qu'une jeune mariée sur quatre âgée de moins de vingt et un ans était enceinte au moment du mariage et qu'un enfant sur six était conçu en dehors des liens du mariage.[xxvi]
Depuis, la censure s’est considérablement assouplie. On citera malgré tout une bavure aussi célèbre qu’incompréhensible. Dans le film Psycho
(Psychose) d’Alfred Hitchcock en 1960, la scène du meurtre dans une douche de chambre d’hôtel du principal personnage
féminin est d’autant plus saisissante qu’on entend de manière très réaliste le poignard s’enfoncer dans le corps de la jeune femme. Le B.B.F.C. demanda que les quatorze coups originels soient
réduits à trois (il y en a huit dans la version française doublée), la séquence durant vingt-deux secondes au lieu de quarante-cinq.
Le B.B.F.C. se montra par ailleurs beaucoup moins sévère face à l’homosexualité (masculine et féminine) ou à certaines formes de perversion. Il accepta Belle de jour de Luis Buñuel (1967), Les Biches de Claude Chabrol (1968)
et The Fox de Mark Rydell (1968), mais refusa The Killing of Sister George de Robert Aldrich (1968). La
police saisit des copies de Flesh d’Andy Warhol (1968) mais le B.B.F.C. le certifia.
Durant les années soixante-dix, la politique des instances de censure s’avéra passablement ambiguë. En 1979, le rapport de la Commission Williams (Williams
Report) mit un terme à une décennie où les tendances réactionnaires (pensons aux campagnes du Festival of Light[xxvii] ou de Mary Whitehouse) tentèrent de regagner le terrain perdu par elles au cours des années soixante. Autant la Commission Williams accorda à la littérature le bénéfice de clergie en postulant qu’il était impossible de
prévoir ce qui demain serait « possible, nécessaire ou désirable »,[xxviii] autant elle jeta la suspicion sur le cinéma qui, par ses techniques (gros plans montage, effets spéciaux, bandes sonores), pouvait
produire sur les spectateurs des réactions dangereuses, comme aucun autre moyen de communication de masse. La télévision fournissant désormais des spectacles “ familiaux ” pour un public
de masse, le cinéma dut fournir des œuvres toujours plus fortes et visant le public des adultes.
Le Board accepta (avec des coupures insignifiantes) des films aussi dérangeants que The
Devils de Ken Russell (1970), inspiré du récit d’Aldous Huxley de 1952 The Devils of Loudun[xxix], A Clockwork Orangede Stanley Kubrick (Orange mécanique) en 1971, Last Tango in
Paris (Le dernier tango à Paris) de Bernardo Bertolucci en
1972 (pour lequel le B.B.F.C. demanda simplement une coupure d’une dizaine de secondes), Le Portier de Nuitde Liliana Calvani et Emmanuelle de Just Jaeckin (1974). En 1976, la censure effaça la bande son lorsque, dans Taxi
Driver de Martin Scorcese, Jodie Foster baisse la fermeture éclair du jeans de Robert de Niro. Le B.B.F.C. accepta des films réellement violents comme
Soldier Blue de Ralph Nelson en 1970, une des descriptions les plus insupportables de la guerre, ou Straw
Dogs (Les chiens de paille) de Sam Pekimpah en 1971, film qui montre la femme d’un écrivain violée par deux
brutes épaisses, les deux hommes étant ensuite assassinés de manière atroce par le mari. En 1975, la censure ne trouva rien à redire à Salo de Pasolini
(d’après Les 120 jours de Sodome de Sade), mais la police londonienne interdit toute représentation dans le quartier de Soho. En 1974, Les
Valseuses de Bertrand Blier fut censuré, non pas parce que deux hommes se partagent les faveurs d’une seule femme, mais parce que la police laisse les deux
héros masculins du film saccager un magasin. La même année, Texas Chainsaw Massacre (Massacre à la tronçonneuse, inspiré par les agissements d’un fermier du Middle-West), suggérant plus qu’il ne montrait, fut interdit pour son efficacité.
En 1978, la Loi sur la Protection des Enfants (The Protection of Children Act) interdit tout film mettant en scène un
enfant de moins de seize ans ayant une relation sexuelle ou assistant à une relation sexuelle. Cette mesure entraîna d’importantes coupures dans Le Tambourde Volker Schlöndorff (1979), alors que ce film était présenté dans son intégralité partout ailleurs en Europe.
Le film de Nagisa Oshima L’empire des sens (1975) finit par obtenir un certificat universel en 1991 (après suppression de
la scène où une femme tire sur le pénis d’un jeune enfant pour le stimuler), tandis que Maîtresse, film sadomasochiste de Barbet Schroeder (1976) était
totalement censuré.
Les ligues de vertu ne parvinrent pas à faire interdire The Life of Brian (La vie de Brian) du Monty Python en 1979.
. L’autocensure
Depuis le début du siècle, l’autocensure s'est perpétuée. Aujourd'hui, les autorités locales ont toujours le droit d'interdire l'accès des salles aux enfants ou
d'empêcher la projection de tel ou tel film. Elles le font généralement après l'avis du B.B.F.C. (les campagnes des ligues de vertu ou la presse dite “ populaire ” sont
heureusement peu fréquentes). Cet organisme n'a toujours pas élaboré de code officiel de censure et il refuse très rarement le certificat d’agrément. Les catégories actuelles sont
“ U ”
pour tout public, “ PG ” (Parental Guidance, Accord parental), l'interdiction aux mineurs de moins de douze, quinze ou dix-huit ans, enfin
“ Restricted 18 ” lorsque la permission n'est accordée qu'à des adultes fréquentant des établissements dont l'accès est privé ou restreint, comme les clubs. S’il y a si peu de films interdits,
c’est parce que les instances professionnelles – en particulier les distributeurs de films
vidéo – exercent un contrôle préalable drastique. Les films pornographiques, soft
ou hard, ne demandent pas à être certifiés. Les films pour adolescents font l’objet de modifications pour ne pas être
censurés. On remplace un “ Fuck ” par un “ Blimey ” (mince, alors !), comme dans Robin Hood : Prince of Thieves (1992) ou Crocodile Dundee. On supprime un long passage de Mrs
Doubtfire avec Robin Williams (1993) parce qu’on imagine que l’ambiguïté sexuelle va trop loin. Mais on peut voir un pénis en érection dans Les amants
du Pont-Neuf de Leos Carax en 1992, film pour tout public. Une très grande liberté est par ailleurs donnée
aux réalisateurs de films sexuels éducatifs. Ainsi, dans Orgasm Workout (1992), Kamasutra 2(1993), on
trouve des scènes de pénétration, de fellation, de cunilingus, mais pas d’éjaculation.
Le B.B.F.C. est également très attentif aux scènes de violence : Platoon d’Oliver Stone (1986) fut
interdit aux moins de 15 ans tandis que Full Metal Jacket de Stanley Kubrick (1987) était réservé aux personnes majeures. Reservoir
Dogs de Quentin Tarentino (1992) fut interdit aux moins de 18 ans, et totalement censuré pour le marché de la vidéo. Rambo III[xxx], Lethal Weapon II (L’arme fatale
II), Terminator II ou Cliffhanger ont fait l’objet de coupures
assez importantes pour pouvoir être montrés aux jeunes de 15 ans. In the Line of Fire (Dans la ligne de mire), film de 1992 avec Clint Eastwood, fut légèrement “ adouci ” par la censure. Dans
les années quatre-vingt-dix, la censure a remanié environ un film sur dix.
. La censure économique
Dans un pays capitaliste comme la Grande-Bretagne, on ne saurait sous-estimer la censure des puissances industrielles. Les films sont distribués par une poignées de
compagnies britanniques (Rank, EMI) ou états-uniennes (Fox, Warner, Paramount). Ces grandes sociétés ont des intérêts dans les chaînes de télévision qui rentabilisent les investissements des
Majors. Sous l’influence de Hollywood, les œuvres tendent de plus en plus à être conçues en termes de produits. En conséquence, ce qui sort de la norme
en matière d’idées ou d’esthétique, ce qui risque de ne pas toucher une partie du public mondial a peu de chance de franchir les innombrables
barrages dans les grands studios. Dans un passé récent, on a vu des films à succès, couronnés par des oscars, avoir, dans un premier temps, toutes les peines du monde à sortir de leur boîte.
Tess, production franco-britannique de Roman Polanski en 1979, basé sur l’un des romans les plus populaires de l’histoire de la littérature
britannique, ne fut montrée sur les écrans anglais que parce qu’elle avait obtenu un fort succès outre-Atlantique. Il en alla de même pour Raging Bull de Martin Scorsese avec Robert De Niro en 1980 et The Stunt Man de Richard Rush avec Peter
O’Toole la même année. La domination financière de Hollywood écrase et fausse la production et la distribution mondiale. Le public britannique ne peut avoir accès qu’à environ trois cents des
quatre mille films tournés chaque année sur la planète. Les écrans anglais sont envahies de production étatsunienne alors que Hollywood ne produit que cinq pour cent du cinéma mondial, moins que
l’Inde, le Japon, ou la France.
La période précédant les élections législatives de 1997 fut propice à un climat de défiance vis-à-vis des films montrant des scènes de violence ou de sexe. Le cas de
pression le plus flagrant fut celui exercé contre Crash de David Cronenberg, cette année-là.
Michael Howard, le ministre de l’Intérieur (conservateur) mena une véritable chasse aux sorcières contre ce film, relayée par plusieurs
personnalités travaillistes. Virginia Bottomley, la Secrétaire du National Heritage, hurla avec les loups, demandant aux autorités locales d’interdire
purement et simplement cette œuvre. Ce débat quasi hystérique au sujet d’un film qui, en France par exemple, ne suscita pas de problème particulier, montra qu’en période électorale les réflexes
moraux prennent le pas sur les exigences de la liberté d’expression.
On peut se demander s'il peut exister de l’excès, par exemple dans la sexualité ou la violence, sans discours sur la sexualité ou la violence, et donc sans
représentation. C'est la question que posait Pierre Bourdieu en tête de son étude de L’Éducation sentimentale : « Qu'est-ce en effet que ce discours qui parle du monde (social ou psychologique)
comme s'il n'en parlait pas ; qui ne peut parler de ce monde que sous la condition qu'il n'en parle que comme s'il n'en parlait pas, c'est-à-dire dans une forme qui opère, pour
l'auteur et le lecteur, une dénégation (au sens freudien de Verneinung) de ce qu'il
exprime ? »[xxxi]. Freud comparait la censure aux “ passages
caviardés ” des journaux. Censurer, c'est installer un “ blanc ” dont le rôle est de
masquer les refoulements, ou au contraire — mais ce qui revient au même — la montée du désir. Souhaiter dire “ bugger ” dans un film
revient à dialectiser un désir, à socialiser une parole, à formaliser un dire. Remplacer “ bugger ” par
“ beggar ”, c'est vouloir évacuer la mise en forme du fantasme avant de censurer le moi et – dans le cas d'un art de masse – la morale collective.
Les créateurs ont été encouragés à se discipliner et les spectateurs invités à respecter les codes de bonne conduite institués dans un esprit consensuel. Le cinéma
britannique (producteurs, créateurs, public) a favorisé la recherche d'une voie moyenne, du bon goût, de ce qu'on nomme en anglais
decency, avec une tendance à écarter l'excès, mais aussi l'ambigu, le symbolique, l'absurde, l'incohérent chaque fois qu'il y avait risque de
défamiliarisation ou de difficulté pour le public à participer pleinement.[xxxii] Naturellement, des créateurs s'insurgèrent contre les limites de l'institution autocensurante censée refléter ou devancer les
préférences des spectateurs, mais qui, volens nolens, défendait les piliers de l'ordre existant. On n'oubliera pas non plus la “ censure ” amicale des
sociétés de production ou de distribution “ conseillant ” à tel ou tel créateur d'abandonner tel ou tel projet pour des raisons de rentabilité. Même si les artistes ont pu être
frustrés par certaines décisions de l'organe de régulation, le cinéma britannique, pour cette période en particulier, n'a pas connu – ce qu'on dénomme outre-Manche, faute de mieux, par une expression française – de cause célèbreidentique à celle du film La
Religieused'après Diderot.
QUELQUES FILMS CÉLÈBRES CENSURÉS
(d’après J.C. Robertson, The Hidden Cinema. British Film Censorship in Action, 1913-1975. Londres : Routledge, 1989.
A Daughter of the Gods
1916. Premier nu féminin de l’histoire du cinéma (nudité de l’héroïne féminine partiellement cachée par de longs cheveux). Film projeté dans
plusieurs grandes villes anglaises mais pas à Londres.
The Betrayal of Lord Kitchener (Comment Lord Kitchener fut trahi)
En juin 1916, le ministre de la Guerre, Lord Kitchener, meurt dans l’explosion
d’un bateau de guerre. Selon le film, l’explosion aurait été l’œuvre de services secrets allemands. En avril 1922, le B.B.F.C. rejeta le film et exerça des pressions sur la France et les
États-Unis pour que le film ne soit pas projeté.
Nosferatu
Adaptation par Friedrich W. Murnau du roman Dracula.Sa censure en 1922 fut à l’origine
de la création de la Film Society.
America
Film de D. W. Griffith en 1924. Raconte l’amour d’un membre de l’armée indépendantiste pour la fille d’un loyaliste en 1775. Le B.B.F.C. leva son
interdiction après trois mois de discussion.
Battleship Potemkin (Le cuirassé Potemkine)
Hommage d’Eisenstein à la Révolution de 1917. Considéré par beaucoup comme le meilleur film du siècle. La sortie du film coïncida avec la Grève
Générale de 1926. La Film Society montra le film dans des assemblées ouvrières. L’Union Soviétique étant l’alliée de la
Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale, le film fut programmé jusqu’en 1946. Pendant la Guerre Froide, le film fut à nouveau censuré. Après la mort de Staline en 1953,
Potemkin fut certifié “ X ”.
King of the Kings (Le Roi des rois)
De Cecil B. de Mille en 1927. Le B.B.F.C. n’accepta pas Jésus-Christ à l’écran. Il fallut attendre 1961, avec une nouvelle version du film par
Nicholas Ray, pour que le censeur lève son interdiction.
The Seashell and the Clergyman (La coquille et le clergyman).
Film de Germaine Dulac en 1927. Jugé trop surréaliste par la censure.
The Miracle Woman
De Frank Capra en 1921. Rejeté parce qu’il contenait des citations “ irrévérencieuses ” de textes religieux.
The Bitch (La Chienne)
Film de Jean Renoir (1931). Trop érotique pour le B.B.F.C..
The Beggar’s Opera (L’Opéra de quat’ sous)
Version française de Georg Pabst en 1930. Rejetée pour sa description du crime organisé.
Carrots (Poil de carotte)
Version de Julien Duvivier en 1932 d’après le roman de Jules Renard. Le B.B.F.C. n’accepta pas la tentative de suicide du jeune enfant.
Life Begins
Film culte de 1932. Une femme mariée enceinte est condamnée pour le meurtre d’un homme qui a tenté de la violer. Les médecins doivent choisir entre
la vie de la mère et celle de l’enfant. Ils choisissent celle du bébé. Le B.B.F.C. leva son interdiction après trois années de combats d’organisations féministes.
Jew Süss (Le Juif Süss)
D’après le roman de Lion Feuchtwanger. Film anti-nazi dont l’histoire se passe au XVIIIème siècle. Le B.B.F.C. fut choqué par la violence.
Interdiction levée en 1934 avec dix minutes de coupures.
The Last Turn (Le dernier tournant)
En mars 1939, le scénario de ce film français (avec Fernand Gravey et Michel Simon), inspiré du roman de James M. Cain Le Facteur sonne toujours
deux fois, est soumis par précaution au B.B.F.C. Le film est censuré.
How Green Was my Valley (Qu’elle était verte ma vallée)
Film de John Ford de 1941. Le B.B.F.C. ne put accepter une grève interminable et une histoire d’amour entre la sœur du héros (mariée mais séparée) et
un pasteur.
No Orchids for Miss Blandish (Pas d’Orchidées pour Miss
Blandish)
Scénario tiré, en 1944, de la pièce à succès de J.H. Chase. Projet rejeté. Soumis de nouveau en 1948. Certifié “ A ” avec des coupures.
The Miracle (L’aurore)
Film de Roberto Rossellini en 1948. L’histoire d’une paysanne simple d’esprit qui voit Saint Joseph en la personne d’un bohémien malfaisant. Elle est
violée, tombe enceinte et s’enfuit pour accoucher de son enfant. Censuré pour la représentation “ scandaleuse” de la nativité.
Keep an Eye on Amelia (Occupe-toi d’Amélie)
Film de Claude Autant-Lara de 1949 d’après Georges Feydeau, avec Danielle Darrieux et Jean Desailly. Raconte les tribulations d’une cocotte vers
1910. Censuré en 1950.
The Wild One (L’équipée sauvage)
Film de 1953 avec Marlon Brando. Refusé en 1954 et 1955 malgré des coupures. Accepté en 1967.
The Blackboard Jungle (Graine de violence)
Film de 1955 avec Glenn Ford et Sidney Poitiers. Refusé en 1955. Accepté après de nombreux changements.
The Man with the Golden Arm (L’Homme au bras d’or)
Film d’Otto Preminger en 1955 avec Frank Sinatra. Certifié “ X ”. La scène où le héros se fait une injection
d’héroïne est coupée.
Trans-Europe Express
Film d’Alain Robbe-Grillet en 1966. Censuré en 1967 pour ses connotations sadiques.
A Clockwork Orange (Orange mécanique) Certifié “ X ” en 1971.
Last Tango in Paris (Dernier tango à Paris) Film de Bernardo
Bertolucci en 1972. Certifié “ X ”.
[i] Geoffrey Pearson.
Hooligan : a History of Respectable Fears, Londres, Macmillan, 1983.
[ii] Des catastrophes non naturelles ont fortement sensibilisé les esprits aux
problèmes de sécurité : l’incendie du Bazar de la Charité à Paris en mai 1897 (cent vingt morts), la fin pour le moins inattendue du Titanic en 1912.
[iii] En France, le système de censure est moins pesant qu’en Grande-Bretagne, mais
particulièrement compliqué. Voir Encyclopædia Universalis, article “ Droit du cinéma ”, tome 5, p. 855.
[iv] Lire P. O'Higgins, Censorship in Britain, Londres, 1972, et D. Tribe, Questions of Censorship, Londres, 1973.
[v] C’est en 1909 qu’on filma pour la première fois en France une exécution
capitale.
[vi] Samuel fut un des rares ministres d’origine juive du début du siècle. Après
avoir travaillé dans les services sociaux de l’East End de Londres, il fut promu au ministère de l’Intérieur où il conçut la législation permettant l’institution de tribunaux pour enfants et
de maisons de redressement (Borstal).
[vii] Par exemple Le Roi des rois de Cecil B. de Mille (1927) qui met en scène Jésus-Christ, ou encore le Ben Hur de Fred Niblo
(1925) qui montre des femmes fort peu habillées.
[viii] De 1948 à 1957, le B.B.F.C. fut dirigé par Arthur Watkins.
[ix] Voir James C. Robertson, The Hidden Cinema. British Film Censorship in
Action, 1913-1975. Londres : Routledge, 1989.
[x] Sans parler de ce qu’on appellera quelques années plus tard la pop music. Voir
Bernard Gensane, L’autre Angleterre, Paris : Bordas, 1971.
[xi] Son penchant pour les films japonais et suédois était connu. Il n’en censura
jamais aucun.
[xii] La peine de mort fut abolie en 1965 pour une période d'essai de cinq ans, puis
définitivement en 1969, assurément contre la majorité de l'opinion publique. L'Abortion Act fut voté en octobre 1967. Une loi de
1929 avait autorisé l'avortement lorsqu'il était accompli “ de bonne foi ” pour préserver la vie de la mère. La loi sur l'homosexualité (Sexual Offences
Act), votée en juillet 1967, permettait des relations homosexuelles entre adultes majeurs consentants. Le Divorce Reform
Act de 1969 introduisait, entre autres, la notion de consentement mutuel. Parallèlement, le Theatres Act de 1968 mettait fin au droit dont disposait le ministre de la Justice de censurer les pièces de théâtre.
[xiii] Le mot était venu naturellement dans la bouche de Tynan, non comme une
grossièreté mais comme un élément d'une explication pédagogique sur la censure des relations sexuelles au théâtre.
[xiv] Mary Whitehouse. Cleaning up T.V. : from Protest to
Participation. Londres, 1967.
[xv] Dans cette affaire, dont on tira des films de fiction, la presse, parfaitement
au courant des tenants et des aboutissants, se censura pendant plusieurs semaines : aucun journaliste n'ayant naturellement tenu la chandelle, les preuves matérielles étaient
impossible à apporter. “ Fleet Street ” avait pu cependant prendre sa revanche sur un scandale précédent : en 1962, des journalistes avaient été jetés en prison pour avoir
refusé de révéler les sources qui les avaient amenés à écrire qu'un haut fonctionnaire, condamné à dix-huit ans de prison pour avoir vendu des secrets à l'URSS, avait eu une liaison avec un
ministre de l'Amirauté. Le bruit avait couru que Lord Carrington, figure importante de la Chambre des Lords et futur ministre de Madame Thatcher, avait trempé dans cette affaire de mœurs et
d’espionnage.
[xvi] What the Censor Saw. Londres, 1973.
[xvii] “ To spare the rod ”, c'est ne pas utiliser une baguette pour punir.
“ Spare the rod and spoil the child ” est l'équivalent en français de “ Qui aime bien châtie bien ”.
[xviii] B.B.F.C. File on Spare the Rod : Reader's report, 25 novembre 1960.
[xix] Le Free Cinema naquit en 1956 lors de la publication du manifeste de Lindsay Anderson, son principal théoricien. Il acquit une réelle indépendance lorsque Tony Richardson
et John Osborne fondèrent la société de production Woodfall Films, soutenue par le réseau de distribution British Lion.
[xx] Ce personnage était joué par Simone Signoret, qui décrocha avec ce rôle le
premier Oscar attribué à un acteur français. Titre du film en français : Les chemins de la haute ville. Dans la
perspective de s’attirer la bienveillance de la censure, le choix d’une actrice française, jouant le rôle d’une française, n’était pas neutre puisque Signoret incarnait un personnage
“ sulfureux ” qui, dans le livre, était anglais. On retrouverait le même syndrome et la même prudence avec l’adaptation du roman de Lynn Reid Bank, The L-Shaped
Room, l’actrice française Leslie Caron jouant le rôle d’une mère célibataire, anglaise dans le roman.
[xxi] Voir Arthur Marwick. “ Room at the Top : the Novel and the Film ” in Marwick (dir.), The Arts, Literature and Society,
Londres, 1990.
[xxii] En 1960, la censure donna un “ A ” à The Entertainer
(avec Laurence Olivier) car une scène suggérait que deux amants avaient fait l’amour sans réel plaisir.
[xxiii] B.B.F.C. File on Look Back in Anger : Readers’ Report, 28 août 1958.
[xxiv] B.B.F.C. File on Look Back in Anger : Readers’ Report, 29 août 1958.
[xxv] Quatre ans après les émeutes raciales de Notting Hill.
[xxvi] John Montgomery. The Fifties, Londres : Allen and Unwin, 1965.
[xxvii] Fondé au début des années soixante-dix, ce rassemblement évangélique prit
ensuite le nom de Christian Action, Research and Education (CARE).
[xxviii] Bernard Williams. Obscenity and Film Censorship, (Cambridge : Cambridge U.P., 1981), p. 55.
[xxix] Il s’agit de l’étude
psychologique d’un groupe de religieuses (censément possédées par le diable) dans la France du XVIIème siècle. Le B.B.F.C. interdit cependant Shock Corridorde Samuel Fuller en 1963 car ce film suggérait que les hôpitaux psychiatriques rendaient vraiment malades ceux qui l’étaient à peine.
[xxx] Rambo I et
Rambo II ne firent l’objet d’aucune coupure. Rambo III sortit
quelques mois après qu’un certain Michael Ryan eut fusillé au hasard des dizaines de passants à Hungerford. Ajoutons que dans les années quatre-vingts, le B.B.F.C. fit une chasse
obsessionnelle à une arme blanche pour le combat rapproché, le “ nunchaku ” (à l’origine un fléau pour battre le riz),
popularisé dans les années soixante-dix par Bruce Lee.
[xxxi] Pierre Bourdieu. Les règles de l'art. Genèse et structure du champ
littéraire. Paris, Le Seuil, 1992.
[xxxii] Un célèbre critique de cinéma des années 50, John Wilcox, résuma cette
problématique dans un article au titre très ironique, “ The Small Knife ” : “ Le fait le plus frappant que l'on découvre lorsqu'on étudie la question de la
censure filmique dans notre pays, c'est que, en dépit de notre dégoût traditionnel pour la censure, presque tout le monde qualifie la situation actuelle de raisonnable. Une telle coopération
entre censeurs et censurés est difficile à concevoir dans tout autre pays. ” Sight and Sound, printemps 1956. Cité par
Jacqueline Louviot, “ Sight and Sound et le cinéma britannique des années cinquante et soixante”, thèse de doctorat,
Université de Strasbourg II, 1997.










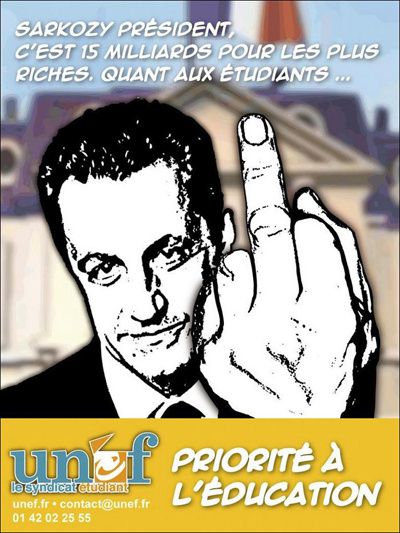


 Depuis quelque temps, le jargon universitaire,
institutionnel est infesté par un certain nombre de sigles qui, comme les nouvelles dénominations des multinationales (Area, Véolia) masquent des réalités très prosaïques : ANR,
RTRA, RTRS, PRES, AERES, IDEX, LABEX etc.
Depuis quelque temps, le jargon universitaire,
institutionnel est infesté par un certain nombre de sigles qui, comme les nouvelles dénominations des multinationales (Area, Véolia) masquent des réalités très prosaïques : ANR,
RTRA, RTRS, PRES, AERES, IDEX, LABEX etc.
/image%2F0549186%2F20210506%2Fob_74c4ce_capture-d-ecran-2021-05-06-a-07-56.png)