Emmanuel Carrère. Le Royaume. P.O.L. : Paris, 2014.
Je vous préviens : je suis un fan d’Emmanuel Carrère. Certainement parce qu’il m’emmène toujours là où je n’avais pas prévu d’aller. J’ai lu et aimé tous ses livres. D’autres vies que la mienne, L’Adversaire m’ont vrillé à jamais. Et puis, je n’ai pas honte de le dire : je trouve qu’il a une bonne tête.

Pour ce qui est du Royaume, je suis mitigé. Je ne sais trop pourquoi l’académie Goncourt n’a pas fait figurer le livre de Carrère dans sa première sélection. Peut-être parce que, selon ses statuts, le Goncourt couronne « un ouvrage d’imagination en prose » et que, justement, Le Royaume, n’est pas – loin s’en faut – que cela.
Bernard Pivot, qui préside la prestigieuse académie, commet un sérieux contresens quand il croit repérer chez Carrère « la satisfaction d’être ce qu’il est et d’écrire ce qu’il écrit. » Que non ! Toute son œuvre montre au contraire les fêlures, les déchirures, les manques, les souffrances. « Content de ce qu’il écrit » ? Je me demande si, avec le recul, il ne sera pas ausssi content que cela du Royaume. Car cet ouvrage manque d’un vrai point de vue (malgré l'allusion à Mai 68 : “ d'où parles-tu ? ”) et, tant dans sa partie autobiographique qu’historique, de réelle profondeur. Lorsque l’on se pique d’écrire 630 pages sur Jésus Christ et ses épigones, on ne le fait pas en dandy, en consacrant plus de cent pages à une crise de foi, prétexte gonflant au texte (même si un écrivain a tous les droits, y compris celui de parler de lui jusqu’à plus soif), et en nous baladant dans une ballade « où tout est plausible », comme il dit à juste titre, mais où la fiction ne permet pas de mieux connaître l’essence de son sujet, même si elle aide à pallier les limites de l’exégète. Et on ne le croit pas sur parole lorsqu’il affirme que, comme Renan, il nous prévient quand il « invente » et qu’il sépare le bon grain du « probable » de l’ivraie du « carrément exclu ». Il n’est pas toujours simple de distinguer entre ce qu’il « imagine » et ce qu’il « pense » en tant qu’analyste de l’histoire. Cela dit, il a parfaitement le droit de se mettre en abyme : « Je suis un écrivain qui cherche à comprendre comment s’y est pris un autre écrivain, et qu’il invente souvent, cela me semble une évidence. » Comme dans ses autres ouvrages, il nous captive mieux que la plupart des spécialistes parce qu’il se place au centre de son récit. Il nous donne par ailleurs l’impression que nous l’accompagnons au long d’un travail en cours, en nous faisant – prétendument – juge de ses motivations. Et il n’hésite pas à instiller des éléments de sa vie privée.
Il n’est pas gênant que l’incipit du livre soit accaparé par Carrère lui-même : « Ce printemps-là, j’ai participé au scénario d’une série télévisée » (Les Revenants). L’excipit est tout de même irritant : « … ce que je suis : un intelligent, un riche, un homme d’en haut : autant de handicaps pour entrer dans le Royaume. » Et pour finir ce « Je ne sais pas. » Carrère veut le beurre et l’argent du beurre : l’agnosticisme de presque toute son existence et la fidélité à la parenthèse de sa brève vie chrétienne.
Comme d’autres, j’ai été agacé par l’utilisation – chez cet écrivain de tout premier plan – d’un français préformaté : « L’appétit pour les religions orientales est ce qu’il y avait de mieux pour le marché. », Paul souffre de « pudibonderie, machisme et homophobie ». Et selon quels paradigmes, je vous prie ? Sans oublier, car c’est, dans ce livre, le fond de son problème d’homme et d’écrivain, comment il se fait que « des gens normaux, intelligents, puissent croire à un truc aussi insensé que la religion chrétienne » ? Le recours à une langue peinarde est un écran de fumée, tout comme, à 250 reprises, l’utilisation d’anachronismes qu’il critique par ailleurs : « Dans un album de Lucky Luke, on verrait [Paul] quitter la ville enduit de goudron et de plumes. » Ou encore : « Comme le général Koutouzov dans Guerre et paix, Vespasien n’aimait pas se presser, donnait du temps au temps. » Quant à Marc, « il parlait aussi bien le grec qu’un chauffeur de taxi de Singapour la langue anglaise » !

On regrette par ailleurs qu’un travail aussi fouillé soit émaillé de lieux communs. Les Écritures sont suffisamment contradictoires, imprécises et farfelues pour ne pas en rajouter : par exemple Paul qui tombe de son cheval, l’antisémitisme à la place de l’antijudaïsme.
Carrère a le grand mérite de nous rappeler quelques bonnes vérités, troublantes pour maints chrétiens. Comme, par exemple, que le culte de Marie n’existait pas au Ier siècle, et donc l'élaboration de son immaculée conception.
Heureusement, ce livre comporte des mises en perspectives, des réflexions saines et utiles : « Les Romains opposaient la religio à la superstitio, les rites qui relient les hommes aux croyances qui les séparent. Ces rites étaient formalistes, contractuels, pauvres de sens et d’affect, mais la résidait justement leur vertu. Pensons à nous, Occidentaux du XXIe siècle. La démocratie laïque est notre religio. Nous ne lui demandons pas d’être exaltantes ni de combler nos aspirations les plus intimes, seulement de fournir un cadre où puisse se déployer la liberté de chacun. Instruits par l’expérience, nous redoutons par-dessus tout ceux qui prétendent connaître la formule du bonheur, ou de la justice, ou de l’accomplissement de l’homme, et la lui imposer. »
J’ai également beaucoup aimé certains raccourcis vertigineux, pleins d’humour, même s’ils jouent un peu avec les canons : « C’est un vague sympathisant [plus exactement un dirigeant pharisien converti sincère], Joseph d’Arimathie, qui décroche le cadavre [du Christ] et le dépose dans une tombe [plus exactement un sépulcre taillé dans le roc]. Toujours pas de disciples dans les parages [en fait, Nicodème, autre dirigeant pharisien – et même s’il est naïf – est présent]. Il n’y a plus à la fin que trois femmes hagardes, celles qui regardaient de loin, et elles ne disent rien à personne parce qu’elles ont peur [précisons : elles ont peur lorsqu’elles découvrent que Jésus a disparu du sépulcre]. Résumons : c’est l’histoire d’un guérisseur rural qui pratique des exorcismes et qu’on prend pour un sorcier. Il parle avec le diable, dans le désert. Sa famille voudrait le faire enfermer. Il s’entoure d’une bande de bras cassés qu’il terrifie par des prédictions aussi sinistres qu’énigmatiques et qui prennent tous la fuite quand il est arrêté. Son aventure, qui a duré moins de trois ans, se termine par un procès à la sauvette et une exécution sordide dans le découragement l’abandon et l’effroi. »
Un prêtre défroqué aurait pu écrire ces lignes.



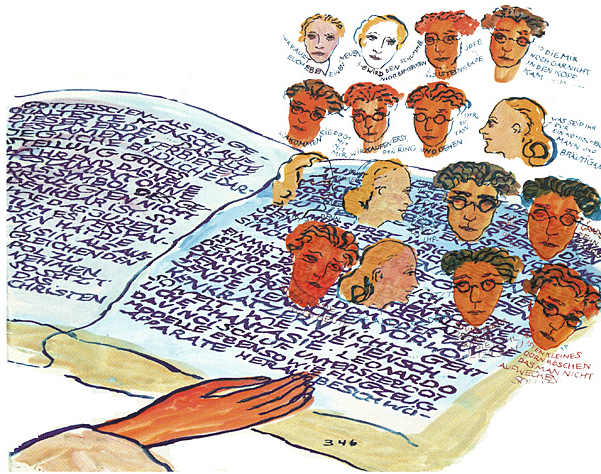













/image%2F0549186%2F20210506%2Fob_74c4ce_capture-d-ecran-2021-05-06-a-07-56.png)